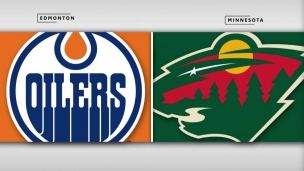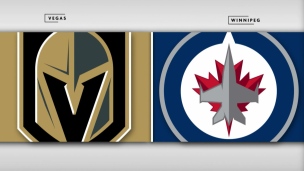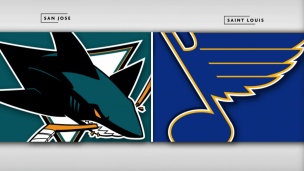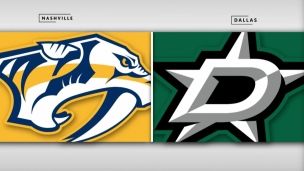Détachés de la réalité
Hockey mercredi, 19 déc. 2012. 09:51 jeudi, 12 déc. 2024. 23:39
On est tous là à se demander ce qu'il adviendra d'un sport florissant, parfois capable de grands spectacles, que des gens totalement détachés de la réalité sont en train de saborder.
Il ne se passe pas une journée sans qu'on analyse cette chicane entre adultes qui paralyse les amphithéâtres de la Ligue nationale. On cherche des coupables dans un camp. On en cherche dans un autre. Pourtant, ils le sont tous. Une fois qu'ils auront fini de s'entre-déchirer sur la place publique, ils devront assumer la responsabilité d'un gâchis inexplicable. Une place publique qu'ils devraient d'ailleurs occuper avec une certaine discrétion pendant qu'ailleurs on regarde une petite communauté sans histoire porter ses enfants en terre.
Si, au moins, ils prenaient une pause pour compatir avec la détresse des autres. Avez-vous entendu un seul joueur, un seul dirigeant de la Ligue nationale, se dire désolé de ce qui s'est passé à Newtown, au Connecticut?
Il n'y a pas de rapport, dites-vous? Pas sûr de ça. Ça reflète le détachement total de cette couche très aisée de la société que représente le monde du hockey. La bataille de ces gens-là est celle d'une industrie qui n'a jamais été aussi prospère et qui est en train de se couvrir de ridicule à la grandeur de l'Amérique parce que patrons et employés ne s'entendent pas sur un mécanisme qui leur permettrait de se partager 3.3 milliards de dollars.
Je m'arrête ici parce que je trouve indécent de me pencher une nouvelle fois sur ce conflit ridicule pendant que le vrai sens de la vie est ailleurs.
Ailleurs, il y a ces enfants symbolisant l'avenir qui ont été sans défense quand un dément est sorti de nulle part pour les mitrailler. Le genre d'enfants qui jouent parfois au hockey dans la rue avec leurs parents tout en souhaitant que papa les invite à un match où ils s'attacheront à ceux qui invoquent actuellement toutes sortes d'excuses pour ne pas retourner à un boulot qui les a fait plusieurs fois millionnaires.
Mardi, à Newtown, on a porté en terre James Mattioli, âgé de six. Durant l'éloge que sa mère a fait de lui, elle a mentionné qu'il pouvait passer des heures et des heures à jouer au hockey. Ces millionnaires lock-outés réalisent-ils qu'ils ont aussi des responsabilités envers leurs très jeunes admirateurs?
Des images marquantes
Si je n'ai pas trop de mal à placer les choses dans une juste perspective, c'est peut-être parce que je suis resté accroché à des images qui m'ont marqué à l'occasion d'un autre massacre, celui de l'école Columbine, à Littleton, au Colorado, où 12 étudiants et un enseignant sont tombés sous les balles de deux jeunes tueurs qui s'étaient jurés d'en tuer 500.
Trois semaines après ce drame, j'étais à Denver pour couvrir les séries de la coupe Stanley. Les pages des quotidiens étaient encore tapissés d'articles et de photos sur le massacre de Columbine. J'avais été particulièrement marqué par celle d'un étudiant de 16 ans dont le côté gauche du visage avait été reconstruit en partie. Il avait été atteint de cinq balles, dont l'une qui l'avait dévisagé. De son lit d'hôpital, il avait accepté qu'on publie sa photo afin que d'autres étudiants blessés, répartis dans trois hôpitaux différents, gardent l'espoir d'une guérison.
À l'époque, l'organisation de l'Avalanche avait démontré sa compassion pour les victimes en greffant sur le chandail des joueurs pour la durée des séries éliminatoires un logo représentant les initiales de ce high school. Des joueurs avaient visité en catimini les survivants de la tuerie et leur avaient distribué encouragements et cadeaux.
L'un des jeunes visités avait déjà vu sa photo faire le tour du monde. On pouvait le voir pendu par une seule jambe à la fenêtre de la bibliothèque, au deuxième étage, avant de tomber dans les bras des policiers de SWAT. Il avait déjà eu le pied droit fracassé par un projectile et deux balles lui avaient troué le crâne. L'une d'elles, toujours emprisonnée dans sa tête, lui tiendra compagnie pour le reste de ses jours.
Il s'appelle Patrick Ireland. J'avais demandé à Pierre Lacroix l'autorisation de l'accompagner quand il lui avait payé une visite personnelle à l'hôpital. J'ai été témoin d'un moment inspirant que je n'ai jamais oublié. Le moral de l'adolescent était bon. Le côté droit de son corps était paralysé. Son élocution était lente. Il allait devoir réapprendre à lire et à écrire.
Pour l'encourager, Lacroix lui avait raconté que son fils Éric, alors avec les Kings de Los Angeles, avait subi dans la même année deux lacérations au visages qui avaient nécessité 100 points de suture.
L'enfant avait été impressionné par ce récit. «Wow, 100 points de suture? J'en ai eu combien, moi,» a-t-il demandé à son père qui assistait à la scène.
La suite des choses nous a donné des chaleurs. Le père a soulevé la casquette de son fils et a commencé à faire le compte. «Tu en as eu 15 ici, a-t-il dit en laissant glisser ses doigts sur le point d'entrée de la première balle. Tu en as eu 12 autres ici, en indiquant l'endroit où la seconde balle l'avait atteint. Et de mémoire, tu en as eu une vingtaine d'autres sur le pied», avait-il ajouté.
Les yeux du gros Pierre avaient roulé dans l'eau. En guise d'espoir, il avait glissé dans la main du garçon une petite coupe Stanley sous la forme d'un porte-clefs, un objet strictement réservé aux joueurs qui devait leur servir d'inspiration dans leur marche vers la coupe. Puis, il lui avait fait la promesse de l'inviter à participer au défilé de la coupe Stanley après les séries.
Malheureusement pour lui, quelques jours plus tard, l'équipe a été éliminée par les Red Wings de Detroit.
Mais ce n'était peut-être pas si grave, après tout. Au cours des mois qui allaient suivre, Patrick Ireland allait être très occupé à guérir les cicatrices qui décoraient son crâne. Des cicatrices qui lui rappelaient qu'il n'y aurait pas eu de défilé pour lui de toute façon s'il avait été du nombre des victimes.
Ça se passait en avril 1999. Quatorze ans plus tard, il n'y aura peut-être pas de séries de la coupe Stanley ce printemps. Entre vous et moi, est-ce qu'on s'en fout?
Laissons-les se chicaner entre eux. Un jour, ils comprendront peut-être que bouder un sport, dont le salaire moyen est supérieur à deux millions $ par saison, constitue un non-sens qu'ils sont les seuls à ne pas réaliser.
Il ne se passe pas une journée sans qu'on analyse cette chicane entre adultes qui paralyse les amphithéâtres de la Ligue nationale. On cherche des coupables dans un camp. On en cherche dans un autre. Pourtant, ils le sont tous. Une fois qu'ils auront fini de s'entre-déchirer sur la place publique, ils devront assumer la responsabilité d'un gâchis inexplicable. Une place publique qu'ils devraient d'ailleurs occuper avec une certaine discrétion pendant qu'ailleurs on regarde une petite communauté sans histoire porter ses enfants en terre.
Si, au moins, ils prenaient une pause pour compatir avec la détresse des autres. Avez-vous entendu un seul joueur, un seul dirigeant de la Ligue nationale, se dire désolé de ce qui s'est passé à Newtown, au Connecticut?
Il n'y a pas de rapport, dites-vous? Pas sûr de ça. Ça reflète le détachement total de cette couche très aisée de la société que représente le monde du hockey. La bataille de ces gens-là est celle d'une industrie qui n'a jamais été aussi prospère et qui est en train de se couvrir de ridicule à la grandeur de l'Amérique parce que patrons et employés ne s'entendent pas sur un mécanisme qui leur permettrait de se partager 3.3 milliards de dollars.
Je m'arrête ici parce que je trouve indécent de me pencher une nouvelle fois sur ce conflit ridicule pendant que le vrai sens de la vie est ailleurs.
Ailleurs, il y a ces enfants symbolisant l'avenir qui ont été sans défense quand un dément est sorti de nulle part pour les mitrailler. Le genre d'enfants qui jouent parfois au hockey dans la rue avec leurs parents tout en souhaitant que papa les invite à un match où ils s'attacheront à ceux qui invoquent actuellement toutes sortes d'excuses pour ne pas retourner à un boulot qui les a fait plusieurs fois millionnaires.
Mardi, à Newtown, on a porté en terre James Mattioli, âgé de six. Durant l'éloge que sa mère a fait de lui, elle a mentionné qu'il pouvait passer des heures et des heures à jouer au hockey. Ces millionnaires lock-outés réalisent-ils qu'ils ont aussi des responsabilités envers leurs très jeunes admirateurs?
Des images marquantes
Si je n'ai pas trop de mal à placer les choses dans une juste perspective, c'est peut-être parce que je suis resté accroché à des images qui m'ont marqué à l'occasion d'un autre massacre, celui de l'école Columbine, à Littleton, au Colorado, où 12 étudiants et un enseignant sont tombés sous les balles de deux jeunes tueurs qui s'étaient jurés d'en tuer 500.
Trois semaines après ce drame, j'étais à Denver pour couvrir les séries de la coupe Stanley. Les pages des quotidiens étaient encore tapissés d'articles et de photos sur le massacre de Columbine. J'avais été particulièrement marqué par celle d'un étudiant de 16 ans dont le côté gauche du visage avait été reconstruit en partie. Il avait été atteint de cinq balles, dont l'une qui l'avait dévisagé. De son lit d'hôpital, il avait accepté qu'on publie sa photo afin que d'autres étudiants blessés, répartis dans trois hôpitaux différents, gardent l'espoir d'une guérison.
À l'époque, l'organisation de l'Avalanche avait démontré sa compassion pour les victimes en greffant sur le chandail des joueurs pour la durée des séries éliminatoires un logo représentant les initiales de ce high school. Des joueurs avaient visité en catimini les survivants de la tuerie et leur avaient distribué encouragements et cadeaux.
L'un des jeunes visités avait déjà vu sa photo faire le tour du monde. On pouvait le voir pendu par une seule jambe à la fenêtre de la bibliothèque, au deuxième étage, avant de tomber dans les bras des policiers de SWAT. Il avait déjà eu le pied droit fracassé par un projectile et deux balles lui avaient troué le crâne. L'une d'elles, toujours emprisonnée dans sa tête, lui tiendra compagnie pour le reste de ses jours.
Il s'appelle Patrick Ireland. J'avais demandé à Pierre Lacroix l'autorisation de l'accompagner quand il lui avait payé une visite personnelle à l'hôpital. J'ai été témoin d'un moment inspirant que je n'ai jamais oublié. Le moral de l'adolescent était bon. Le côté droit de son corps était paralysé. Son élocution était lente. Il allait devoir réapprendre à lire et à écrire.
Pour l'encourager, Lacroix lui avait raconté que son fils Éric, alors avec les Kings de Los Angeles, avait subi dans la même année deux lacérations au visages qui avaient nécessité 100 points de suture.
L'enfant avait été impressionné par ce récit. «Wow, 100 points de suture? J'en ai eu combien, moi,» a-t-il demandé à son père qui assistait à la scène.
La suite des choses nous a donné des chaleurs. Le père a soulevé la casquette de son fils et a commencé à faire le compte. «Tu en as eu 15 ici, a-t-il dit en laissant glisser ses doigts sur le point d'entrée de la première balle. Tu en as eu 12 autres ici, en indiquant l'endroit où la seconde balle l'avait atteint. Et de mémoire, tu en as eu une vingtaine d'autres sur le pied», avait-il ajouté.
Les yeux du gros Pierre avaient roulé dans l'eau. En guise d'espoir, il avait glissé dans la main du garçon une petite coupe Stanley sous la forme d'un porte-clefs, un objet strictement réservé aux joueurs qui devait leur servir d'inspiration dans leur marche vers la coupe. Puis, il lui avait fait la promesse de l'inviter à participer au défilé de la coupe Stanley après les séries.
Malheureusement pour lui, quelques jours plus tard, l'équipe a été éliminée par les Red Wings de Detroit.
Mais ce n'était peut-être pas si grave, après tout. Au cours des mois qui allaient suivre, Patrick Ireland allait être très occupé à guérir les cicatrices qui décoraient son crâne. Des cicatrices qui lui rappelaient qu'il n'y aurait pas eu de défilé pour lui de toute façon s'il avait été du nombre des victimes.
Ça se passait en avril 1999. Quatorze ans plus tard, il n'y aura peut-être pas de séries de la coupe Stanley ce printemps. Entre vous et moi, est-ce qu'on s'en fout?
Laissons-les se chicaner entre eux. Un jour, ils comprendront peut-être que bouder un sport, dont le salaire moyen est supérieur à deux millions $ par saison, constitue un non-sens qu'ils sont les seuls à ne pas réaliser.