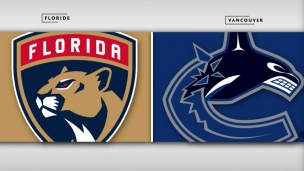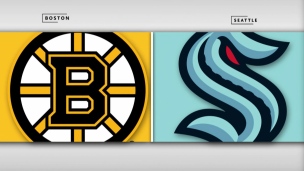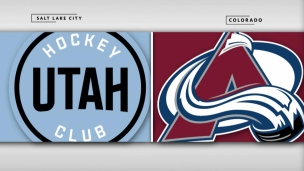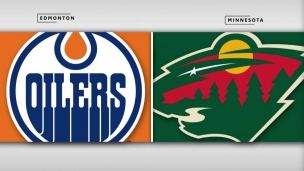Quel bagarreur, Pat Burns!
Hockey samedi, 20 nov. 2010. 13:19 vendredi, 13 déc. 2024. 08:46
Il y a quelques mois, j'ai écrit à Pat Burns. Je n'avais jamais écrit à un homme de hockey dans ma vie. Je l'ai fait parce que j'étais impressionné par son comportement professionnel.
J'avais eu mes différends avec lui. Il avait levé le ton plusieurs fois devant moi, mais le lendemain, il agissait toujours comme s'il ne s'était rien passé. Il était comme ça, Pat. Pas rancunier pour cinq cents.
J'étais impressionné en l'écoutant religieusement chaque matin à CKAC. À 7h30 pile, il était là, beau temps, mauvais temps. Dans les bons comme dans les mauvais moments de sa maladie. Des matins, il semblait en super forme. On le sentait prêt à reprendre le boulot derrière le banc d'une équipe de la Ligue nationale, tellement il avait de l'entrain. Deux ou trois jours plus tard, sa voix redevenait rauque, son élocution plus lente. Le gros ours en arrachait, c'était l'évidence même.
Je voulais qu'il sache que la dure bataille qu'il livrait depuis quatre ans et son assiduité à se présenter au micro chaque matin constituait pour moi, à mon âge et après plus de 40 ans de métier, une source d'inspiration. J'étais étonné de la somme de travail qu'il investissait dans chacune de ses interventions. De son intégrité radiophonique aussi. Dans son rôle, il aurait pu rouler très longtemps sur son vécu. Il aurait pu nous servir très souvent des : « Moi, dans mon temps... »
Il prenait cette seconde carrière très à coeur. On aurait dit que c'est ce qui le tenait en vie. Il était toujours si bien préparé. Le soir, il pouvait regarder trois ou quatre matchs télévisés en même temps. À sa sortie du lit, il sautait sur l'internet pour s'informer des dernières nouvelles. Il pouvait nous rapporter ce qu'on racontait dans les quotidiens de Toronto, de Phoenix ou de Columbus. Il savait tout. Dans sa quête d'informations, il était régulièrement au téléphone avec son réseau de contacts et d'amis. Quand il appelait quelque part, on ne prenait pas le message. On lui parlait. Pat, c'était quelqu'un dans le hockey.
En l'écoutant à la radio, je me disais qu'il représentait un merveilleux exemple pour la jeune génération de journalistes et de commentateurs qui gravitent dans le milieu, parfois avec l'impression de tout savoir. En fait, il était une source d'inspiration autant pour les jeunes que pour les vétérans du métier parce qu'il était merveilleusement documenté, parce qu'il n'avait pas perdu l'instinct de travailleur qui avait marqué sa carrière d'entraîneur et parce qu'il ne laissait pas la maladie et les souffrances physiques l'éloigner de ce qu'il a toujours été comme homme.
Quand on demande à Serge Savard, qui lui a donné sa première chance dans la ligue, ce qu'il avait vu en Pat Burns pour lui accorder pareil vote de confiance, il pourrait nous parler de son énergie, de sa poigne solide dans un vestiaire, de ses talents de motivateur ou de ses habiletés techniques. Il résume plutôt tout ça dans un simple bout de phrase : « Vous savez, Pat, c'était un gros travaillant. »
Personnellement, je conserve de lui un souvenir très intense des quatre années et des 320 matchs que j'ai passés dans son entourage, de nos fréquents entretiens, des dizaines d'entrevues qu'il m'a accordées et dont je me suis inspiré pour tenter d'avoir l'air brillant certains jours.
Néanmoins, comment pourrais-je oublier nos prises de bec souvent générées par mon refus de succomber à son intimidation quand le ton devenait aussi élevé que ses baguettes en l'air. Certains jours, dans ses contacts avec les médias, ses vieilles habitudes de policier remontaient à la surface. Il prenait des airs bourrus et sa plus grosse voix pour créer un effet certain parmi les journalistes visés. Les plus jeunes s'écrasaient, plus par peur que par respect.
Il acceptait mal que je puisse sourire dans ces moments-là, mais après avoir passé huit ans dans l'entourage de Scotty Bowman, à subir son style particulier, ses moments d'arrogance et son langage châtié, je ne pouvais pas avoir peur de Burns. Bowman, c'était le summum en matière d'intimidation.
Un beau moment
Mon dernier contact avec lui a été à Québec quand le commissaire de la Ligue junior majeur du Québec, Gilles Courteau, a eu la merveilleuse idée de réunir Jacques Demers, Michel Bergeron, Bowman et lui dans le cadre du Défi des espoirs, en 2007. Il fallait le voir badiner avec Demers et Bergeron, pour lequel il avait un faible dans le hockey, pour comprendre tout le plaisir qu'il ressentait à se retremper dans un milieu qui l'avait vu naître comme entraîneur, celui du hockey junior.
Quand il affichait son visage ténébreux derrière le banc des quatre formations qu'il a dirigées dans la Ligue nationale, si on lui avait dit que sa vie serait marquée un jour par un moment de bonheur comme lui-là, il s'en serait moqué. Mais il revenait de loin. Ça change un homme, un combat pour sa propre vie.
« Les effets de cette maladie sont terrifiants, me fait remarquer son frère Alfred qui a passé une dernière journée à ses côtés dimanche dernier. Ça ronge le corps. La tête reste vivante et alerte, mais le corps s'effrite. Il était devenu maigre comme un manche à balai. Il ne restait plus rien de sa solide charpente. »
Il n'y a pas que Pat qui était totalement épuisé au cours des dernières semaines. Line, qui n'a jamais cessé de l'appuyer dans cette bataille et qui a pris soin de lui comme on veille sur un bébé aux prises avec une grosse fièvre, était extrêmement fatiguée, elle aussi. Ces derniers temps, elle quittait la maison chaque matin vers huit heures pour le conduire à l'hôpital et elle le ramenait dans son lit vers 20 heures. Cette très difficile épreuve, c'est à deux qu'ils l'ont traversée.
Son frère a eu le bonheur de passer du bon temps en sa compagnie en Floride au cours des dernières années. Il s'agissait de moments précieux puisque Pat ne laissait par entrer qui le voulait dans son quotidien pendant qu'il soignait ses trois cancers, au colon (2004), au foie (2005) et aux poumons (2009).
« Pat était distant avec nous tous, dit-il. Il ne voulait pas voir des gens qui avaient de la peine autour de lui. Il souhaitait les voir vivre leur propre vie et être heureux. Dans sa forme de langage habituel, il disait qu'il ne voulait pas voir du braillage autour de lui. Il préférait vivre ça en paix avec Line. D'ailleurs, il a toujours été renfermé avec les membres de la famille. Pas parce qu'il ne nous aimait pas. Il était fait comme ça. »
« Pat n'avait que trois ans quand notre père est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 49 ans, ajoute Alfred Burns. C'est comme si notre famille s'était brisée. Il était le cadet de la famille. Nous nous sommes mariés; nous avons eu des enfants. Chacun a fait son chemin. Pat et notre soeur Diane sont allés s'établir à Gatineau avec notre mère et le reste de la famille est demeuré à Montréal. »
Quelle bataille il a livrée
Le cancer a fait son apparition durant la série Devils-Flyers, au printemps de 2004. Il est resté derrière le banc mais par le plus curieux des hasards, les Devils ont été éliminés d'une façon expéditive. Comme si la Providence avait jugé bon de le remettre entre les mains des médecins le plus rapidement possible.
Dans le point de presse qui a suivi, Burns a rendu sa maladie publique. « Vous me connaissez, a-t-il dit avec une certaine assurance. Je n'ai jamais refusé un combat et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Je vais me battre. »
Et quelle bataille il a livrée! Ce printemps, dans le bureau d'un spécialiste de la Floride avec lequel il s'était lié d'une profonde amitié, il a compris qu'il avait tenu promesse. « Quand je t'ai rencontré pour la première fois, je te donnais une année à vivre, lui a dit le médecin. Ça fait quatre ans et tu es toujours là. »
À son frère, il a raconté qu'il avait fait la paix avec tout le monde, notamment avec Dieu. Il savait aussi qu'il vivait sur du temps emprunté et qu'il n'avait rien à gagner à pleurer sur son sort.
Il a sans doute pleuré avec Line certains soirs. Comment aurait-il pu en être autrement? Il était heureux avec cette femme chaleureuse et fort jolie qu'il avait épousée à Boston en 1998 et à laquelle il n'avait surtout pas le goût d'imposer son calvaire. Pour le reste, ils ont vécu cette lourde épreuve, la tête bien haute, le corps bien droit.
Si seulement certains personnes mesquines n'avaient pas décidé de remettre à plus tard son intronisation au Panthéon du hockey, Burns aurait su tout le bien que le monde du hockey pensait de lui avant de mourir. C'est ce qui me chagrine le plus dans ce départ qu'on savait inévitable puisqu'il rencontrait tous les critères d'admissibilité : Plus de 1000 matchs et de 500 victoires, une coupe Stanley, trois trophées Jack Adams et 15 ans derrière le banc.
Il aurait aimé être témoin de cela, mais il n'aurait surtout pas voulu qu'on le fasse parce qu'il était sur le point de partir. Mais comme me le fait remarquer son frère, il aurait certainement mérité d'obtenir une bonne nouvelle avant son départ.
J'avais eu mes différends avec lui. Il avait levé le ton plusieurs fois devant moi, mais le lendemain, il agissait toujours comme s'il ne s'était rien passé. Il était comme ça, Pat. Pas rancunier pour cinq cents.
J'étais impressionné en l'écoutant religieusement chaque matin à CKAC. À 7h30 pile, il était là, beau temps, mauvais temps. Dans les bons comme dans les mauvais moments de sa maladie. Des matins, il semblait en super forme. On le sentait prêt à reprendre le boulot derrière le banc d'une équipe de la Ligue nationale, tellement il avait de l'entrain. Deux ou trois jours plus tard, sa voix redevenait rauque, son élocution plus lente. Le gros ours en arrachait, c'était l'évidence même.
Je voulais qu'il sache que la dure bataille qu'il livrait depuis quatre ans et son assiduité à se présenter au micro chaque matin constituait pour moi, à mon âge et après plus de 40 ans de métier, une source d'inspiration. J'étais étonné de la somme de travail qu'il investissait dans chacune de ses interventions. De son intégrité radiophonique aussi. Dans son rôle, il aurait pu rouler très longtemps sur son vécu. Il aurait pu nous servir très souvent des : « Moi, dans mon temps... »
Il prenait cette seconde carrière très à coeur. On aurait dit que c'est ce qui le tenait en vie. Il était toujours si bien préparé. Le soir, il pouvait regarder trois ou quatre matchs télévisés en même temps. À sa sortie du lit, il sautait sur l'internet pour s'informer des dernières nouvelles. Il pouvait nous rapporter ce qu'on racontait dans les quotidiens de Toronto, de Phoenix ou de Columbus. Il savait tout. Dans sa quête d'informations, il était régulièrement au téléphone avec son réseau de contacts et d'amis. Quand il appelait quelque part, on ne prenait pas le message. On lui parlait. Pat, c'était quelqu'un dans le hockey.
En l'écoutant à la radio, je me disais qu'il représentait un merveilleux exemple pour la jeune génération de journalistes et de commentateurs qui gravitent dans le milieu, parfois avec l'impression de tout savoir. En fait, il était une source d'inspiration autant pour les jeunes que pour les vétérans du métier parce qu'il était merveilleusement documenté, parce qu'il n'avait pas perdu l'instinct de travailleur qui avait marqué sa carrière d'entraîneur et parce qu'il ne laissait pas la maladie et les souffrances physiques l'éloigner de ce qu'il a toujours été comme homme.
Quand on demande à Serge Savard, qui lui a donné sa première chance dans la ligue, ce qu'il avait vu en Pat Burns pour lui accorder pareil vote de confiance, il pourrait nous parler de son énergie, de sa poigne solide dans un vestiaire, de ses talents de motivateur ou de ses habiletés techniques. Il résume plutôt tout ça dans un simple bout de phrase : « Vous savez, Pat, c'était un gros travaillant. »
Personnellement, je conserve de lui un souvenir très intense des quatre années et des 320 matchs que j'ai passés dans son entourage, de nos fréquents entretiens, des dizaines d'entrevues qu'il m'a accordées et dont je me suis inspiré pour tenter d'avoir l'air brillant certains jours.
Néanmoins, comment pourrais-je oublier nos prises de bec souvent générées par mon refus de succomber à son intimidation quand le ton devenait aussi élevé que ses baguettes en l'air. Certains jours, dans ses contacts avec les médias, ses vieilles habitudes de policier remontaient à la surface. Il prenait des airs bourrus et sa plus grosse voix pour créer un effet certain parmi les journalistes visés. Les plus jeunes s'écrasaient, plus par peur que par respect.
Il acceptait mal que je puisse sourire dans ces moments-là, mais après avoir passé huit ans dans l'entourage de Scotty Bowman, à subir son style particulier, ses moments d'arrogance et son langage châtié, je ne pouvais pas avoir peur de Burns. Bowman, c'était le summum en matière d'intimidation.
Un beau moment
Mon dernier contact avec lui a été à Québec quand le commissaire de la Ligue junior majeur du Québec, Gilles Courteau, a eu la merveilleuse idée de réunir Jacques Demers, Michel Bergeron, Bowman et lui dans le cadre du Défi des espoirs, en 2007. Il fallait le voir badiner avec Demers et Bergeron, pour lequel il avait un faible dans le hockey, pour comprendre tout le plaisir qu'il ressentait à se retremper dans un milieu qui l'avait vu naître comme entraîneur, celui du hockey junior.
Quand il affichait son visage ténébreux derrière le banc des quatre formations qu'il a dirigées dans la Ligue nationale, si on lui avait dit que sa vie serait marquée un jour par un moment de bonheur comme lui-là, il s'en serait moqué. Mais il revenait de loin. Ça change un homme, un combat pour sa propre vie.
« Les effets de cette maladie sont terrifiants, me fait remarquer son frère Alfred qui a passé une dernière journée à ses côtés dimanche dernier. Ça ronge le corps. La tête reste vivante et alerte, mais le corps s'effrite. Il était devenu maigre comme un manche à balai. Il ne restait plus rien de sa solide charpente. »
Il n'y a pas que Pat qui était totalement épuisé au cours des dernières semaines. Line, qui n'a jamais cessé de l'appuyer dans cette bataille et qui a pris soin de lui comme on veille sur un bébé aux prises avec une grosse fièvre, était extrêmement fatiguée, elle aussi. Ces derniers temps, elle quittait la maison chaque matin vers huit heures pour le conduire à l'hôpital et elle le ramenait dans son lit vers 20 heures. Cette très difficile épreuve, c'est à deux qu'ils l'ont traversée.
Son frère a eu le bonheur de passer du bon temps en sa compagnie en Floride au cours des dernières années. Il s'agissait de moments précieux puisque Pat ne laissait par entrer qui le voulait dans son quotidien pendant qu'il soignait ses trois cancers, au colon (2004), au foie (2005) et aux poumons (2009).
« Pat était distant avec nous tous, dit-il. Il ne voulait pas voir des gens qui avaient de la peine autour de lui. Il souhaitait les voir vivre leur propre vie et être heureux. Dans sa forme de langage habituel, il disait qu'il ne voulait pas voir du braillage autour de lui. Il préférait vivre ça en paix avec Line. D'ailleurs, il a toujours été renfermé avec les membres de la famille. Pas parce qu'il ne nous aimait pas. Il était fait comme ça. »
« Pat n'avait que trois ans quand notre père est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 49 ans, ajoute Alfred Burns. C'est comme si notre famille s'était brisée. Il était le cadet de la famille. Nous nous sommes mariés; nous avons eu des enfants. Chacun a fait son chemin. Pat et notre soeur Diane sont allés s'établir à Gatineau avec notre mère et le reste de la famille est demeuré à Montréal. »
Quelle bataille il a livrée
Le cancer a fait son apparition durant la série Devils-Flyers, au printemps de 2004. Il est resté derrière le banc mais par le plus curieux des hasards, les Devils ont été éliminés d'une façon expéditive. Comme si la Providence avait jugé bon de le remettre entre les mains des médecins le plus rapidement possible.
Dans le point de presse qui a suivi, Burns a rendu sa maladie publique. « Vous me connaissez, a-t-il dit avec une certaine assurance. Je n'ai jamais refusé un combat et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Je vais me battre. »
Et quelle bataille il a livrée! Ce printemps, dans le bureau d'un spécialiste de la Floride avec lequel il s'était lié d'une profonde amitié, il a compris qu'il avait tenu promesse. « Quand je t'ai rencontré pour la première fois, je te donnais une année à vivre, lui a dit le médecin. Ça fait quatre ans et tu es toujours là. »
À son frère, il a raconté qu'il avait fait la paix avec tout le monde, notamment avec Dieu. Il savait aussi qu'il vivait sur du temps emprunté et qu'il n'avait rien à gagner à pleurer sur son sort.
Il a sans doute pleuré avec Line certains soirs. Comment aurait-il pu en être autrement? Il était heureux avec cette femme chaleureuse et fort jolie qu'il avait épousée à Boston en 1998 et à laquelle il n'avait surtout pas le goût d'imposer son calvaire. Pour le reste, ils ont vécu cette lourde épreuve, la tête bien haute, le corps bien droit.
Si seulement certains personnes mesquines n'avaient pas décidé de remettre à plus tard son intronisation au Panthéon du hockey, Burns aurait su tout le bien que le monde du hockey pensait de lui avant de mourir. C'est ce qui me chagrine le plus dans ce départ qu'on savait inévitable puisqu'il rencontrait tous les critères d'admissibilité : Plus de 1000 matchs et de 500 victoires, une coupe Stanley, trois trophées Jack Adams et 15 ans derrière le banc.
Il aurait aimé être témoin de cela, mais il n'aurait surtout pas voulu qu'on le fasse parce qu'il était sur le point de partir. Mais comme me le fait remarquer son frère, il aurait certainement mérité d'obtenir une bonne nouvelle avant son départ.