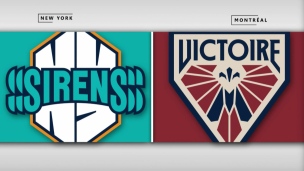Anecdotes de quarantaine : mon premier match
Sports divers mardi, 5 mai 2020. 08:00 mardi, 5 mai 2020. 10:38
MONTRÉAL - De Denis Gauthier qui gèle Wayne Gretzky à Marc Griffin qui gèle devant Tim Raines, nos anciens joueurs nous racontent l’histoire derrière leur plus mémorable « première fois ».
Denis Gauthier : pas de privilège pour le grand Wayne
Il y avait une loi non-écrite dans la Ligue nationale en 1997 : on ne touchait pas à Wayne Gretzky. Pas de coup d’épaule, pas de coup de bâton, rien. À deux ans de la retraite, la Merveille avait bien mérité ce traitement de faveur. Mais des commandements comme celui-là, ça me passait six pieds par-dessus la tête. J’avais 21 ans, j’avais amassé plus de 600 minutes de pénalité dans le junior et les Flames de Calgary ne m’avaient pas repêché pour mes beaux yeux. J’étais un jeune coq, je voulais faire ma place, je voulais impressionner et avec mon style de jeu, il fallait que je me distingue avec mon jeu physique.
Je m’en souviens comme si c’était hier : ça s’était passé devant le banc des punitions en première période. Gretzky, qui évoluait alors pour les Rangers de New York, ne m’avait pas vu venir, je l’avais frappé le plus fort que je pouvais et il s’était retrouvé les quatre fers en l’air.
Le reste du match avait été assez chaotique. Un après l’autre, ses coéquipiers avaient voulu le venger. Je ne me souviens pas du score final ou de ma performance en général, mais je me souviens très bien que ce fut un match éprouvant physiquement et émotivement. En plus d’avoir à gérer un stress naturel pour mon premier match, je savais que j’avais réussi à entrer dans la tête des 20 joueurs de l’autre côté. Disons que j’avais bien fait mon travail ce soir-là.
Le plus drôle, c’est qu’en 2005-2006, j’étais avec les Coyotes de Phoenix pour la première saison de Gretzky comme entraîneur-chef dans la LNH. Dans une réunion en début de saison, on revenait sur le camp et on parlait des attentes et des objectifs pour l’année. Il m’avait dit qu’il avait l’intention de me faire jouer contre les meilleurs joueurs adverses, il voulait que je sois physique et que je dérange. Il m’avait dit : « Te souviens-tu comment tu m’avais frappé à Calgary? C’est comme ça que je veux que tu joues. » Je l’avais frappé assez fort pour qu’il s’en souvienne encore huit ans plus tard. J’étais bien fier de mon coup quand il m’a dit ça.
Pierre Vercheval : carence d’oxygène
Je suis arrivé à Edmonton en septembre 1988, fraîchement retranché du camp d’entraînement des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. À peine une semaine plus tard, je vivais mon baptême dans la LCF. J’étais habité par toutes les émotions qu’on peut associer à ce genre de première, mais pour ajouter à l’intensité du moment, j’allais participer à l’un des grands classiques du football canadien : le match du lundi de la Fête du Travail où les Stampeders de Calgary accueillent les Eskimos, leurs grands rivaux albertains. Je sais que les comparaisons avec le hockey peuvent être hasardeuses, mais je suis prêt à dire que ça pouvait ressembler à la rivalité Canadien-Nordiques.
J’ai toujours été un petit joueur de ligne à l’attaque, mais j’étais reconnu pour posséder de bonnes qualités athlétiques pour mon gabarit. À l’époque, les équipes de la LCF n’étaient composées que de 38 joueurs; inutile de dire qu’un réserviste qui était moindrement agile était surutilisé sur les unités spéciales. Pour mon premier match, le coordonnateur des unités spéciales avait décidé qu’il m’impliquerait dans les quatre phases majeures de son département : bottés de dégagement, retours de bottés de dégagement, bottés d’envoi et retours de bottés d’envoi. Je n’aurais pas le temps de chômer.
Le match commence et c’est le festival du botté de dégagement. Aucune des deux équipes n’est capable de s’imposer en attaque. Deux jeux, on dégage. Deux jeux, on reprend le ballon. Je lutte dans les tranchées, je sprinte comme un défoncé. Après le premier quart, je suis complètement brûlé, tellement que pour la première fois de ma carrière, j’ai la brillante idée d’aller prendre une bouteille d’oxygène comme j’avais souvent vu d’autres joueurs le faire sur les lignes de côté.
Mais je me suis vite aperçu que de l’oxygène pur, ça ne sert à rien si tu n’as pas un niveau de cardio assez élevé! J’essayais d’en prendre, mais à moment donné, il faut que ton corps soit capable de l’absorber. J’avais garoché la bouteille au bout de mes bras en maugréant. Mon coach de ligne à l’attaque, Gary Durchik, était venu me voir pour me demander si je pensais être capable de finir le match. Il me disait que j’étais rouge comme une tomate et qu’il pensait que j’allais mourir sur le banc.
À la mi-temps, j’ai enfin l’occasion de prendre mon souffle. J’entre dans le vestiaire et une drôle d’odeur m’arrive aux narines. Je me demande ce qui se passe, je me retourne... et je m’aperçois que quelques joueurs sont en train de fumer la cigarette! Et puis à côté de la porte, il y avait je ne sais trop combien de caisse de douze qui étaient sur la glace pour la fin du match. Je capotais. Ce n’était pas vraiment l’image que je me faisais du sport professionnel. Bienvenue chez les pros, le kid!
Au final, j’avais quand même réussi à faire une belle performance. De mémoire, j’avais eu trois plaqués sur les unités spéciales et j’avais partiellement bloqué un botté de dégagement.
Éric Bélanger : un trio respectable
Je garde un bon souvenir de mes débuts dans le hockey junior majeur. À 16 ans, dans ce qui était peut-être mon deuxième ou troisième match avec les Harfangs de Beauport, j’avais marqué mon premier but contre mon frère Luc, qui était gardien pour les Faucons de Sherbrooke. Ça s’était passé à Sherbrooke, notre ville natale, en plus. Difficile d’oublier ça. Mais rien ne va battre mon premier match dans la Ligue nationale.
J’avais 22 ans. Les Kings de Los Angeles m’avaient repêché en quatrième ronde cinq ans plus tôt et j’avais enfin la chance de commencer la saison avec eux. J’avais connu un bon camp d’entraînement, mais en plus, Jozef Stumpel faisait la grève et c’est moi que l’entraîneur Andy Murray avait décidé de garder pour prendre sa place.
La saison commençait à Washington. Pour les matchs sur la route, Murray avait l’habitude de glisser une feuille sous la porte de notre chambre d’hôtel très tôt le matin. Au réveil, on connaissait nos compagnons de trio, l’alignement de l’équipe adverse et les principaux points stratégiques à respecter. C’est comme ça que j’ai appris que j’allais jouer mon premier match dans la LNH entouré de Luc Robitaille et Zigmund Palffy.
Luc était un vétéran à l’époque. Il m’avait juste dit : « Donne-moi le puck dans la slot, le kid, pis ça va ben aller! » Il avait marqué deux buts dans les onze premières minutes de la partie et j’avais récolté une passe sur les deux. En deuxième période, mes deux ailiers avaient mis la table pour mon premier but dans la LNH. Le gardien était Craig Billington.
J’ai eu le temps de jouer huit matchs avant que Stumpel ne finisse par signer son contrat. Je suis retourné dans la Ligue américaine jusqu’à ce qu’on me rappelle à la fin novembre. Je n’y suis plus jamais descendu.
Marc Griffin : larcin devant témoin
J’ai signé mon premier contrat professionnel avec les Dodgers de Los Angeles en 1988, à mon retour des Jeux olympiques de Seoul. J’avais 20 ans en février 1989 quand j’ai reçu une invitation pour participer au camp des ligues majeures de l’organisation. C’était gros!
La première fois que j’ai vu de l’action dans un match de la Ligue des Pamplemousses, c’était au Holman Stadium de Vero Beach contre les Expos de Montréal. La sortie des vestiaires était au champ droit et notre abri était le long de la ligne du troisième, alors j’avais dû passer devant celui des Expos pour m’y rendre. Une fois assis, j’avais l’impression de m’être trompé de côté. Je capotais.
Dans le calendrier préparatoire, les joueurs réguliers sont habituellement appelés à jouer les cinq ou six première manches pour ensuite céder la place à des jeunes qui tentent de monter les échelons. En septième manche, on m’envoie au premier but comme coureur suppléant. Je mets mon pied sur le coussin et, comme il se doit dans pareille situation, je scrute le champ extérieur afin de noter où sont positionnés les voltigeurs. Mon regard arrive au champ gauche et j’aperçois Tim Raines.
Je gèle. Je suis tellement pris par les émotions que je demande un temps d’arrêt et je me penche en faisant semblant que mon lacet est détaché. Dans ma tête, je ne suis encore qu’un petit gars qui regarde le baseball à la télé, mais me voilà sur un terrain des ligues majeures vêtu de l’uniforme des champions en titre de la Série mondiale, obéissant à un ordre du grand Tommy Lasorda. En plus, en arrivant au coussin, j’entends l’annonceur maison me présenter comme un joueur natif de « Montreal, Canada ». Voir Raines à l’autre bout du terrain, ça m’a achevé.
Une fois remis de mes émotions, Manny Mota, notre instructeur au premier but, me rappelle de regarder les signaux. On me demande le vol. Le receveur, si je me souviens bien, est Nelson Santovenia. La présence de Raines m’obsède et tout ce que je veux, c’est voler un but sous ses yeux. Je commence à me faire des scénarios : « si je glisse sauf au deuxième, je vais le regarder! » Le jeu reprend et je sors de mes rêveries. J’ai un bon départ sur le premier lancer, mais Mike Scioscia frappe une fausse balle. Je suis aussi en course sur le lancer suivant, mais il frappe un roulant au deuxième but. La manche est terminée.
Ça aura été bref, et pas si glorieux, comme entrée en matière. J’aurais pu vous parler d’autres premières fois un peu plus éclatantes, comme mes trois coups sûrs contre David Cone à mon premier départ dans le pro. Mais il y a quelque chose de cette courte apparition contre les Expos qui m’a marqué à jamais. La fois où je voulais voler un but devant mon idole.
Martin Biron : la prophétie de Noël
J’avais été l’un des derniers joueurs retranchés au camp de sélection d’Équipe Canada junior en décembre 1995. Je suis revenu à Beauport juste avant Noël et le 24 décembre, je reçois un appel de Larry Carrière, qui était alors l’adjoint au directeur général à Buffalo. Son message : les Sabres ont besoin de moi à Pittsburgh. Je dois être là pour le 25 en prévision du match du 26. Il y a des blessures au sein de l’effectif et je suis leur dernier recours. À 18 ans, j’allais passer un Noël mémorable.
Je suis parti avec ma poche des Harfangs et le seul habit que je possédais. Je suis arrivé à Pittsburgh le 25, comme on me l’avait demandé, alors que le reste de l’équipe devait seulement arriver tôt le lendemain. Le 26 au matin, j’attends dans le lobby de l’hôtel quand Kenny Martin, un des responsables des communications de l’équipe, vient me voir. Il me dit que personne ne peut venir me chercher parce que l’équipe est en retard pour la pratique et qu’il faudra se rendre à l’aréna en taxi. Mais le 26 décembre, les taxis ne courent pas les rues. On a donc traîné mon équipement à pied, une jambière dans une main et une bretelle du sac de l’autre, tout en haut de la grande côte à Pittsburgh, pour prendre part à l’entraînement matinal.
Je n’avais aucune idée de ce qui m’attendait. J’ai dit salut aux boys et j‘ai eu 15 minutes pour pratiquer. Je m’attendais à jouer un rôle de figurant, mais Steve Shields, mon partenaire, m’avait bien fait comprendre que c’était moi qui allais obtenir le départ en soirée. Quelqu’un me l’avait sans doute déjà annoncé, mais il se passait tellement de choses dans ma tête que j’avais probablement compris tout croche.
C’est drôle parce que quelques jours plus tôt, je regardais le match entre le Canadien et les Penguins à la télé. Jocelyn Thibault avait joué tout un match et Montréal l’avait emporté par blanchissage, 1-0. Je m’étais alors dit que la prochaine équipe qui allait affronter les Penguins était mieux d’être prête parce qu’elle allait y goûter. Jamais je n’aurais pu me douter que ça allait être moi entre les deux poteaux quand Mario et sa bande me donneraient raison! J’ai donné quatre buts sur 24 tirs avant de me faire remplacer par Steve et on a finalement perdu le match 6-3.
Marc Denis : Campbellton-Montréal, un aller simple à l’aube
J’ai été le tout premier choix au repêchage de l’histoire de l’Avalanche du Colorado. Pour le camp d’entraînement, quelques mois plus tard, l’équipe avait gardé le calendrier préparatoire qu’auraient dû avoir les Nordiques, ce qui fait qu’on s’était envolés de Denver pour venir s’établir à Montréal. Une fois arrivé, j’avais pris un autobus avec les autres recrues pour aller jouer un match à Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Tard après le match, Bob Hartley m’avait appelé pour me dire que j’avais un avion à prendre à 5h le lendemain matin. On voulait que je joue contre Patrick Roy et le Canadien, deux jours plus tard, au Forum. Le contraste allait être frappant et c’est ce qui fait qu’encore aujourd’hui, ces souvenirs sont si clairs pour moi.
L’année suivante, j’ai joué mon premier vrai match dans la Ligue nationale. J’étais encore d’âge junior et j’avais été rappelé par mesure d’urgence, le temps que Craig Billington se remette d’une blessure. Sur la dizaine de matchs que l’équipe a joués en ma présence, j’ai obtenu un départ. C’était à l’autre Forum, le Great Western Forum à Los Angeles. J’affrontais les Kings de Philippe Boucher, Ray Ferraro et Luc Robitaille. On avait perdu 4-2 et j’avais été bon pour mes adversaires québécois : Boucher avait marqué contre moi, tout comme Yanic Perreault. Steven Finn avait obtenu une passe.
C’est drôle parce que les vétérans avaient décidé de faire coïncider ce voyage en Californie avec le traditionnel souper des recrues. Je m’en étais toutefois sauvé parce que j’avais pris un avion dès le lendemain pour me rendre complètement à l’autre bout du continent, à Halifax, où ma petite routine du junior m’attendait. J’avais retrouvé mon équipe pour un seul match. Ensuite, le temps de faire une brassée de lavage et je partais rejoindre l’équipe nationale pour un camp de sélection à Kitchener. Tout se bousculait, c’était exaltant.
J’ai bâti de belles relations dans ce premier bref séjour avec le grand club. Patrick Roy avait trouvé les bons mots pour me rassurer. Claude Lemieux, qui était mon cochambreur, avait été bon avec moi. Mike Ricci, de qui je suis resté assez proche, et Keith Jones, qui fait aujourd’hui le même métier que moi avec les Flyers, avaient aussi été de précieux alliés.
Wandrille Lefèvre : une entrée décisive
Un défenseur central qui commence le match sur le banc ne s’attend pas à dépenser beaucoup de calories ce jour-là. À moins d’une blessure ou d’une expulsion, ce n’est généralement pas un poste auquel un entraîneur aura tendance à faire une substitution. Mon entrée dans le match était encore plus improbable en ce 27 avril 2013 : je jouais derrière les vétérans Alessandro Nesta et Matteo Ferrari à une position qui m’était encore complètement inconnue. J’avais toujours été un milieu de terrain avant que Frank Klopas ne fasse de moi un défenseur à ma première saison chez les pros.
C’était un match contre le Fire de Chicago au Stade Saputo. La deuxième demie venait de commencer et j’étais à moitié en train de rêver sur le banc quand j’ai entendu quelqu’un crier mon nom. « Wandou! Wandou! » Je me retourne et on me dit : « Change toi, tu entres ». Nesta venait de se blesser. Je n’ai même pas eu le temps de ressentir le stress ou la pression. L’instant d’après, littéralement, j’étais sur le terrain pour mes toutes premières minutes en MLS. Pas le temps de cogiter, il faut livrer!
Ce qui est marrant, c’est que le tout premier ballon qui arrive à mes pieds, je le renvoie sur une diagonale de 60 mètres à Andrés Romero... qui marque! Ça te lance une carrière, disons! Ce fut le premier but d’une victoire de 2-0. On dit souvent qu’une carrière est une accumulation de petits moments. Parfois, tu as une chance et tu dois la saisir. C’est ce que j’avais fait : jamais plus je n’ai quitté la position de défenseur central par la suite.
André Roy : nuit blanche à Boston
Je n’étais pas un vilain joueur de hockey dans le junior. À 19 ans, j’avais peut-être obtenu plus de 300 minutes de punition, mais j’avais aussi marqué 33 buts en 54 matchs. Mais un des dépisteurs des Bruins de Boston, qui m’avaient repêché en sixième ronde, m’avait fait comprendre qu’ils m’avaient pris parce que j’étais un tough et que c’était ça qu’ils voulaient que j’amène, rien d’autre. Ça avait été dur à entendre, mais j’ai fini par me faire à l’idée que ça serait mon rôle et que je devais ajuster mon style. Quand je me préparais pour un match, je ne pensais pas vraiment à jouer la game, mais plutôt à ceux contre qui je pourrais laisser tomber les gants.
J’ai commencé la saison 1995-96 dans la Ligue américaine. Les Bruins m’ont rappelé un peu après les Fêtes, à quelques jours de mon 21e anniversaire. Mon cadeau : affronter les Sabres de Buffalo, qui comptaient dans leur formation des durs comme Rob Ray, Brad May, Matthew Barnaby et Bob Boughner. Je vous le dis sans gêne : je n’ai presque pas dormi la veille du match et je n’ai pas été capable de fermer l’œil le lendemain pour la sieste. Je ne pouvais pas arrêter de penser à ces matamores que j’avais vus si souvent à la télé. Ray me faisait carrément peur et je savais qu’avec May, ça sortait aussi bien des deux poings. Vous n’avez pas idée à quel point j’étais nerveux. Je peux le dire aujourd’hui : je n’étais pas prêt mentalement à aller affronter ces gars-là.
Je pense que j’ai fait un total de trois présences dans le match et laissez-moi vous dire que je gardais ça simple : un peu d’échec-avant, un bon repli et je m’en retournais directement au banc! J’avais joué trois matchs en une semaine avec les Bruins et je ne m’étais toujours pas battu quand ils m’ont retourné à Providence.
Matthieu Proulx : un trip de chums avec les Alouettes
J’étais nerveux à mon premier camp d’entraînement dans la Ligue canadienne. Je me demandais sincèrement si j’allais être capable de me tailler une place au sein de l’équipe. J’ai éventuellement compris que lorsque tu es un choix de première ronde – j’avais été le cinquième choix au total – il faut vraiment que tu fasses n’importe quoi sur le terrain pour être retranché. L’équipe a trop investi en toi pour ne pas te garder dans ses rangs. Quand même, le stress ne m’a pas quitté avant un bon bout de temps. Je me souviens de la première fois que j’ai revêtu l’uniforme des Alouettes. C’était quand même surréaliste à mes yeux. Mon premier match préparatoire était contre les Roughriders d’Ottawa. C’était spécial pour moi qui avais grandi à Gatineau.
Mon premier match officiel était contre les Tiger-Cats de Hamilton. J’avais un rôle sur les unités spéciales. Mon début de carrière a été un peu lent, en réalité. Je ne me suis pas établi tout de suite, je n’ai pas fait de gros coup d’éclat au départ. Mais quand même, la première fois que tu es dans le tunnel qui mène au terrain, tu te dis « Ok, c’est pour vrai ! ». Ce qui a rendu ce match doublement mémorable, c’est que je l’ai joué avec Phillip Gauthier, qui est mon grand chum d’enfance. C’est lui qui m’avait initié à jouer au foot et de vivre ce moment avec lui, c’était très cool non seulement pour nous, mais pour nos deux familles. Je me souviens qu’on avait tenté de bloquer un botté et qu’on avait écopé d’une punition pour avoir rudoyé le botteur. J’avais tellement eu peur de la réaction de Don Matthews, qui pouvait être assez violent comme personne. J’avais aussi été puni pour rudesse sur un retour de botté.
Patrick Côté : « mords-lui la nuque! »
J’ai souvent raconté l’histoire de mon premier combat à l’UFC contre Tito Ortiz, une méga-star qui était sur le fond d’écran de mon ordinateur quand j’ai reçu un appel inespéré pour l’affronter en 2004. Mais deux ans plus tôt, c’est dans des circonstances pas mal moins glorieuses que je lançais ma carrière professionnelle.
Ça se passait au Millenium, un bar à Laval. Il y avait peut-être 100 personnes dans la place, c’était tout petit. Les spectateurs étaient pas mal maganés et leurs « encouragements » se rendaient facilement à nos oreilles. Des « pogne-le à la gorge! » et « mords-y la nuque! », j’en ai entendu! Je représentais alors Team Union, une équipe de jiu-jitsu brésilien, et mon adversaire était un dénommé Pascal Gosselin. Sans être un ami, je le connaissais bien puisqu’on venait tous les deux de Sherbrooke. Il avait déjà cinq combats pros à sa fiche quand on s’est affrontés. Ça n’a pas été une longue histoire. Je me souviens de lui être rentré dedans pour amener le combat au sol très rapidement. Ma technique n’était pas trop chic, mais ça avait fonctionné et j’étais allé chercher l’étranglement arrière peu de temps après. Ça s’est passé vraiment vite. Chez les amateurs, j’avais souvent perdu assez lamentablement, alors ma première victoire, ça avait fait du bien. J’ai gagné mes quatre combats suivants, puis les portes de l’UFC s’étaient ouvertes devant moi.
Maxime Talbot : savourer le moment
J’ai su peut-être deux ou trois jours avant le début de la saison 2005-2006 que je m’étais taillé un poste au sein de la formation des Penguins. Ed Olczyk, l’entraîneur de l’époque, m’avais annoncé la nouvelle dans les gradins du Mellon Arena. C’était une certaine surprise, mais je l’avais mérité. L’équipe avait quelques joueurs de centre sur la liste des blessés et j’avais été l’un de ceux qui avaient connu un bon camp. J’étais très content.
Mon baptême a eu lieu au New Jersey, dans le vieux Continental Airlines Arena. À mes côtés dans le vestiaire, il y avait une autre recrue, Sidney Crosby. Mais la réalité, c’est qu’on était une équipe un peu vieillissante : Mario Lemieux, John LeClair, Mark Recchi m’entouraient pendant que j’enfilais mon uniforme. C’était toute une expérience. Je me souviens que j’avais vraiment pris le temps de regarder à gauche, à droite. J’ai pris mon temps pour mettre mon chandail. Si je peux me permettre de faire une boucle, j’avais fait la même chose six ans plus tard, après la saison 2010-2011, quand je sentais que je ne reviendrais pas avec les Penguins.
Et de l’autre côté, il y avait Martin Brodeur. En première période, j’avais eu un 2-contre-1 avec Matt Murley en désavantage numérique. J’avais pris un bon lancer du bord de la mitaine, mais Brodeur avait fait l’arrêt. C’était assez impressionnant, mais quand tu es plongé dedans, c’est comme n’importe quel autre moment. Je veux dire, tu réalises l’importance de ce que tu vis, mais il faut que tu vives le moment sinon tu vas geler. Comme un match numéro 7 en séries.
Depuis que j’étais jeune, mon rêve était de jouer un match dans la LNH. Dès que ce match contre les Devils a pris fin, mon rêve est devenu de gagner la Coupe.
Bruno Gervais : bouche bée devant le buffet
Pour me récompenser pour mon bon début de saison dans la Ligue américaine, les Islanders de New York avaient procédé à mon rappel en décembre 2005. Je devenais le septième défenseur de l’équipe; l’idée, c’était de m’intégrer progressivement dans la LNH en me faisant vivre quelques moments avec le grand club. Tout était calculé : pour quelques matchs, je jouerais deux présences en première période, deux autres en deuxième et ensuite je resterais assis sur le banc. Mais on voulait me faire voyager et me permettre d’apprendre à connaître ceux qui seraient un jour mes coéquipiers à temps plein.
J’ai joué mon premier match au défunt Joe Louis Arena, à Detroit. C’était un match en après-midi, donc il n’y avait pas eu d’entraînement matinal ce jour-là, mais l’équipe nous fournissait quand même le repas d’avant-match. C’est là que j’avais constaté que les buffets de la LNH et ceux de la Ligue américaine, c’était deux mondes! Le brunch était tout simplement cinglé! Certains gars s’étaient pris un petit-déjeuner ordinaire, mais d’autres, je ne sais pas si c’était par appétit ou par superstition, s’étaient enfilé du filet mignon et du saumon. Mon menton était tombé par terre tellement c’était copieux.
Pour ma première présence sur la patinoire, mon partenaire était Alexei Zhitnik, un maudit bon Jack avec qui j’ai eu bien du plaisir. C’est arrivé après un temps d’arrêt, une pause qui, à mes yeux, a dû durer un bon quart d’heure! Je regarde de l’autre côté et je sais que je vais affronter Brendan Shanahan, Pavel Datsyuk et Daniel Cleary. Je ne suis pas un gars nerveux de nature, mais je me rappelle que des doigts dans mes deux mains étaient devenus engourdis et que mes avant-bras pétillaient! La rondelle s’était retrouvée derrière notre gardien, Rick DiPietro, et je l’avais sauvé. Les gars ont eu bien du fun avec ça. Les vétérans avaient été bons avec moi.
Avec le recul, je suis heureux d’avoir vécu ce moment dans un amphithéâtre aussi mythique. C’est là que s’était gagnée la coupe Stanley cette année-là, mais le jour de mon premier match, c’est nous qui avions eu le dernier mot. D’ailleurs, dans toute ma carrière, je n’ai jamais perdu un match au vieux Joe.