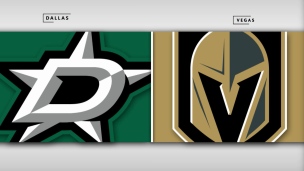Boivin ne voulait pas être président du CH
Hockey lundi, 16 mai 2011. 09:44 mardi, 30 avr. 2024. 09:39
Au moment où il s'apprête à quitter la présidence du Canadien, Pierre Boivin n'est pas peu fier de ce qu'il a accompli depuis un peu moins de 12 ans. C'est une fierté bien légitime.
Il ne voulait pas de cette lourde responsabilité au départ. Quand on l'avait approché pour remplacer Ronald Corey, il avait clairement indiqué qu'il n'était pas intéressé. Après avoir dit non une seconde fois, un chasseur de têtes l'avait finalement convaincu d'accepter le poste prestigieux que plusieurs auraient occupé sans se poser de questions.
Il n'avait jamais rêvé d'une carrière dans le sport professionnel. Il avait 45 ans. Il n'était pas convaincu d'avoir ce qu'il fallait pour relever un défi aussi colossal.
«L'aspect public d'une position comme celle-là fait peur quand on n'est jamais passé par là, explique-t-il. On ignore si on aura la sérénité ou l'épiderme assez épais pour affronter la critique. Se faire critiquer publiquement, ça peut ronger son homme. J'avais des enfants au secondaire à l'époque. Ça peut jouer dur dans les cours d'école quand l'équipe perd. Nous savions aussi que n'aurions plus de samedis à nous. Bien sûr, le partisan en moi apprécie se retrouver au Centre Bell le samedi soir, mais il y a 1 000 employés au travail. Alors, je suis sur la job. Après y avoir bien réfléchi, je me suis mis le bras dans l'engrenage et la machine m'a vite avalé.»
Pourquoi a-t-il dit oui, finalement?
«J'ai accepté parce qu'il s'agissait du Canadien qui avait toujours été mon équipe. À titre de détenteur d'une demi-loge avec Bauer et d'abonnements de saison, j'en avais ras-le-bol des performances décevantes de l'équipe. Je l'ai fait parce que le Canadien avait besoin d'être redressé et d'être modernisé.»
C'est en plein ce qu'il a fait. Sous sa gouverne, l'organisation a été assise sur des bases solides. Un puissant lien d'appartenance a été créé avec le public. Une opération marketing de tous les instants a permis à l'équipe de jouir d'une visibilité accrue. L'organisation, qui a navigué dans le rouge durant quelques années, engrange aujourd'hui des profits faramineux. Boivin laisse donc le Canadien dans une santé financière remarquable. Bien sûr, il n'a pas accompli cela tout seul, mais il a été le chef d'orchestre d'un personnel compétent dont les tâches étaient réglées au quart de tour, ce qui a rendu possible ce succès assez remarquable.
Boivin est étrangement serein pour un homme qui, par la force des choses, se voit contraint d'abandonner le poste numéro un de l'organisation la plus visible au Québec. Dans son bureau, quelques boîtes de carton attendent qu'il y enfouisse souvenirs, photos de famille et autres objets personnels. Dans deux jours, il ne sera plus là.
Il nous reçoit dans une tenue décontractée, portant jeans chic et chemise à carreaux. Il est là de corps, mais il n'y est plus vraiment. Mercredi, il quittera le septième étage qui a été sa deuxième demeure depuis 12 ans pour ne plus y revenir. Le départ risque de lui faire vivre un moment de grande émotion lui qui, sous des dehors rigides, possède une sensibilité à fleur de peau.
Il a déjà refusé quelques propositions qui auraient pu lui permettre d'aller répéter ailleurs le redressement qu'il a orchestré de brillante façon chez le Canadien. Il n'a jamais pris le temps d'y réfléchir. C'était déjà très clair entre sa femme et lui; il n'était pas question de s'expatrier.
Les Boivin, on le sait, ont vécu de très dures épreuves dans le passé. Plus que jamais, ils désirent se serrer les coudes. Ils ont perdu deux enfants. Trois autres vivent près d'eux. Éventuellement, peut-être dans un proche avenir, il y aura des petits-enfants. C'est ici, à Montréal et dans la belle région de Knowlton où ils possèdent une résidence secondaire, qu'ils aspirent à passer du temps de qualité en famille.
«Quand on m'a approché, je ne suis jamais allé plus loin que de dire : «Merci beaucoup, je l'apprécie, je suis flatté». En revenant à la maison, j'apprenais à Lucie que j'avais reçu un appel dans la journée. Ça s'arrêtait là. C'était déjà une affaire classée», explique-t-il.
L'ex-président du Canadien a choisi de savourer une seconde passion. Il s'en va diriger Claridge, une société d'investissement privé. C'est un secteur d'activité qui l'intéresse depuis longtemps, selon ses dires.
Mais on jase, là. On ne sait jamais ce que l'avenir réserve. Qui dit que le hockey ne lui manquera pas dans un an ou deux? Qui dit qu'il ne tapera pas du pied en revivant avec nostalgie l'expérience emballante qu'il a connue au Centre Bell. Or, dans deux ans, les Nordiques de Québec seront peut-être là. Qui mieux que lui, après le retentissant succès que le Canadien a connu sous sa gouverne, pourrait relancer et administrer cette équipe? Sans compter qu'il n'aurait pas à trop s'éloigner de la maison.
«La suggestion est plutôt amusante, lance-t-il en souriant. Ma femme est native de la région de Québec, sa mère y habite, sa soeur y travaille. Cela ne serait pas un déménagement. Ce serait davantage un retour aux sources.»
Il s'empresse toutefois de mettre le couvercle sur cette possibilité avant que la marmite déborde de rumeurs. Il sait à quel point les commérages de hockey circulent vite au Québec.
«Cette étape de ma vie est franchie, ajoute-t-il. Le livre est complété. Je ne conserve que de bons souvenirs. J'ai maintenant le goût d'aller faire autre chose. Quand tu t'engages dans une position senior au sein d'une entreprise de la taille et du prestige de Claridge, tu t'investis à long terme. J'ai toujours conservé mes emplois durant 10 ou 12 ans. Je ne suis pas un gars qui favorise le court terme. Je suis loyal.»
Pas facile de rendre des comptes
Pierre Boivin a fini de rendre des comptes à toute une province. Chez Claridge, il ne sera pas constamment sous les réflecteurs. Il n'aura plus à expliquer publiquement les décisions de l'entreprise. Chez le Canadien, c'est une obligation qui l'a parfois placé dans l'embarras. Il a dû apprendre à mieux choisir ses mots et à jouer du violon dans certains cas. Il rappelle deux situations qui lui ont fait comprendre que le président du Canadien n'est pas monsieur Tout-le-Monde.
En 2003, il avait déclaré à l'auteur de ces lignes que le Canadien était dans un grand trou noir d'où il ne pourrait s'extirper avant cinq ans. Il rappelle en souriant que le Journal de Québec avait jumelé ses propos à une caricature représentant une bombe prête à exploser. C'est là qu'il avait réalisé l'importance de mieux choisir ses expressions.
Par ailleurs, deux ans après son entrée en poste, il avait ignoré un engagement de Serge Savard qui avait l'habitude de dire qu'à talent égal, le Canadien allait toujours choisir le joueur francophone. Dans le cadre d'une conférence, il avait affirmé que deux athlètes ne pouvaient jamais être de talent égal.
«Je m'étais fait joyeusement ramasser. Je ne pensais pas que je survivrais à ça. Même Donald Beauchamp m'avait grondé. Par la suite, je me suis fait à l'idée de jouer davantage la carte du politicien», précise-t-il, l'air amusé.
Malgré tout, il croit que cette responsabilité auprès du public lui manquera. Il affirme qu'il y a un petit quelque chose de revalorisant quand on a l'impression d'avoir assez bien assumé cette mission. C'est enivrant de savoir que le Canadien touche autant de monde, tant par ses hauts que par ses bas.
Il part plus tôt que prévu (son mandat devait se terminer le 30 juin) parce que la transition est complétée, parce que le nouveau venu Kevin Gilmore a déjà le nez dans tous les dossiers depuis un mois et parce que l'organisation traverse actuellement une période importante pour les budgets et la planification fiscale. Avec Geoff Molson, Gilmore et lui, c'était important que le Canadien ne projette pas une direction à trois têtes, selon lui.
La décision de Geoff Molson n'a pas été un choc
La décision du propriétaire d'aller s'asseoir dans le fauteuil du président ne l'a pas jeté par terre. Néanmoins, on quitte rarement le Canadien de gaieté de coeur, peu importe le poste qu'on occupe.
La nouvelle ne lui est pas tombée dessus comme une tonne de briques, cependant. M. Molson n'est pas entré dans son bureau en lui disant: «Désolé, mon vieux, mais c'est terminé.» Ce n'est surtout pas de cette façon que les choses se sont passées.
Il a vu venir la chose. Il a même prédit à son propriétaire que c'est précisément ce qu'il allait faire.
Deux semaines après la vente de l'équipe, Boivin a eu une première rencontre exploratoire avec le nouveau propriétaire.
Geoff Molson et lui se connaissaient fort bien puisque le jeune homme d'affaires siégeait déjà au sein du comité de direction du Canadien. Il représentait la tranche de 19% des actions qui faisaient de Molson le propriétaire minoritaire de l'équipe.
Ce jour-là, Boivin ne lui a demandé qu'une chose, celle de lui faire part de ses plans le plus rapidement possible. «J'étais un grand garçon; j'étais prêt à tout. C'est à ce moment que Geoff m'a annoncé son intention de quitter la Brasserie Molson et de s'installer au Centre Bell. Il m'a précisé qu'il n'avait aucun intérêt pour mon poste. Il voulait présider le conseil d'administration et gérer l'investissement de son groupe de partenaires. Cela lui apportait déjà suffisamment de responsabilités. Je lui ai prédit, au contraire, qu'il serait éventuellement tenté par mon poste.»
Quand Molson et son groupe se sont portés acquéreurs du Canadien, c'était déjà beaucoup pour le jeune entrepreneur. Il avait 38 ans. Il venait d'investir beaucoup d'énergie dans la création d'un groupe de partenaires. Toutefois, avec le temps, il a fait un cheminement qui l'a inévitablement convaincu de la nécessité d'en devenir le président. Boivin admet que s'il avait été dans la position de Molson, il aurait pris exactement la même décision. Voilà pourquoi il accepte son départ avec autant de sérénité.
Fait plutôt cocasse, pendant deux ou trois mois l'automne dernier, le jeune propriétaire a discuté avec Boivin des modalités du renouvellement de son contrat. Le président sortant n'a jamais vraiment cru qu'il se rendrait au bout de cette négociation.
«Je n'ai pas été surpris par sa décision de prendre possession de mon bureau, avoue-t-il. Je m'étais préparé pour une chose comme celle-là. Je suis heureux de la façon dont les choses se sont passées. Je suis satisfait d'avoir réussi à ramener l'entreprise entre les mains de Québécois et d'avoir participé à une transition sereine, sans claquage de portes, où tout le monde trouve sa place.»
Néanmoins, il lui sera très difficile de faire ses adieux à ses collaborateurs et collaboratrices du septième étage, mercredi. Il s'attend à vivre des derniers instants difficiles. Quand la porte de l'élévateur va se refermer derrière lui, en le laissant avec plein de souvenirs qui se bousculeront dans sa tête, il sait parfaitement ce qui va se passer.
«Je vais pleurer, c'est sûr, dit-il. Il va falloir que je m'essuie la face avant de me présenter dans le stationnement.»
(La suite mercredi)
Il ne voulait pas de cette lourde responsabilité au départ. Quand on l'avait approché pour remplacer Ronald Corey, il avait clairement indiqué qu'il n'était pas intéressé. Après avoir dit non une seconde fois, un chasseur de têtes l'avait finalement convaincu d'accepter le poste prestigieux que plusieurs auraient occupé sans se poser de questions.
Il n'avait jamais rêvé d'une carrière dans le sport professionnel. Il avait 45 ans. Il n'était pas convaincu d'avoir ce qu'il fallait pour relever un défi aussi colossal.
«L'aspect public d'une position comme celle-là fait peur quand on n'est jamais passé par là, explique-t-il. On ignore si on aura la sérénité ou l'épiderme assez épais pour affronter la critique. Se faire critiquer publiquement, ça peut ronger son homme. J'avais des enfants au secondaire à l'époque. Ça peut jouer dur dans les cours d'école quand l'équipe perd. Nous savions aussi que n'aurions plus de samedis à nous. Bien sûr, le partisan en moi apprécie se retrouver au Centre Bell le samedi soir, mais il y a 1 000 employés au travail. Alors, je suis sur la job. Après y avoir bien réfléchi, je me suis mis le bras dans l'engrenage et la machine m'a vite avalé.»
Pourquoi a-t-il dit oui, finalement?
«J'ai accepté parce qu'il s'agissait du Canadien qui avait toujours été mon équipe. À titre de détenteur d'une demi-loge avec Bauer et d'abonnements de saison, j'en avais ras-le-bol des performances décevantes de l'équipe. Je l'ai fait parce que le Canadien avait besoin d'être redressé et d'être modernisé.»
C'est en plein ce qu'il a fait. Sous sa gouverne, l'organisation a été assise sur des bases solides. Un puissant lien d'appartenance a été créé avec le public. Une opération marketing de tous les instants a permis à l'équipe de jouir d'une visibilité accrue. L'organisation, qui a navigué dans le rouge durant quelques années, engrange aujourd'hui des profits faramineux. Boivin laisse donc le Canadien dans une santé financière remarquable. Bien sûr, il n'a pas accompli cela tout seul, mais il a été le chef d'orchestre d'un personnel compétent dont les tâches étaient réglées au quart de tour, ce qui a rendu possible ce succès assez remarquable.
Boivin est étrangement serein pour un homme qui, par la force des choses, se voit contraint d'abandonner le poste numéro un de l'organisation la plus visible au Québec. Dans son bureau, quelques boîtes de carton attendent qu'il y enfouisse souvenirs, photos de famille et autres objets personnels. Dans deux jours, il ne sera plus là.
Il nous reçoit dans une tenue décontractée, portant jeans chic et chemise à carreaux. Il est là de corps, mais il n'y est plus vraiment. Mercredi, il quittera le septième étage qui a été sa deuxième demeure depuis 12 ans pour ne plus y revenir. Le départ risque de lui faire vivre un moment de grande émotion lui qui, sous des dehors rigides, possède une sensibilité à fleur de peau.
Il a déjà refusé quelques propositions qui auraient pu lui permettre d'aller répéter ailleurs le redressement qu'il a orchestré de brillante façon chez le Canadien. Il n'a jamais pris le temps d'y réfléchir. C'était déjà très clair entre sa femme et lui; il n'était pas question de s'expatrier.
Les Boivin, on le sait, ont vécu de très dures épreuves dans le passé. Plus que jamais, ils désirent se serrer les coudes. Ils ont perdu deux enfants. Trois autres vivent près d'eux. Éventuellement, peut-être dans un proche avenir, il y aura des petits-enfants. C'est ici, à Montréal et dans la belle région de Knowlton où ils possèdent une résidence secondaire, qu'ils aspirent à passer du temps de qualité en famille.
«Quand on m'a approché, je ne suis jamais allé plus loin que de dire : «Merci beaucoup, je l'apprécie, je suis flatté». En revenant à la maison, j'apprenais à Lucie que j'avais reçu un appel dans la journée. Ça s'arrêtait là. C'était déjà une affaire classée», explique-t-il.
L'ex-président du Canadien a choisi de savourer une seconde passion. Il s'en va diriger Claridge, une société d'investissement privé. C'est un secteur d'activité qui l'intéresse depuis longtemps, selon ses dires.
Mais on jase, là. On ne sait jamais ce que l'avenir réserve. Qui dit que le hockey ne lui manquera pas dans un an ou deux? Qui dit qu'il ne tapera pas du pied en revivant avec nostalgie l'expérience emballante qu'il a connue au Centre Bell. Or, dans deux ans, les Nordiques de Québec seront peut-être là. Qui mieux que lui, après le retentissant succès que le Canadien a connu sous sa gouverne, pourrait relancer et administrer cette équipe? Sans compter qu'il n'aurait pas à trop s'éloigner de la maison.
«La suggestion est plutôt amusante, lance-t-il en souriant. Ma femme est native de la région de Québec, sa mère y habite, sa soeur y travaille. Cela ne serait pas un déménagement. Ce serait davantage un retour aux sources.»
Il s'empresse toutefois de mettre le couvercle sur cette possibilité avant que la marmite déborde de rumeurs. Il sait à quel point les commérages de hockey circulent vite au Québec.
«Cette étape de ma vie est franchie, ajoute-t-il. Le livre est complété. Je ne conserve que de bons souvenirs. J'ai maintenant le goût d'aller faire autre chose. Quand tu t'engages dans une position senior au sein d'une entreprise de la taille et du prestige de Claridge, tu t'investis à long terme. J'ai toujours conservé mes emplois durant 10 ou 12 ans. Je ne suis pas un gars qui favorise le court terme. Je suis loyal.»
Pas facile de rendre des comptes
Pierre Boivin a fini de rendre des comptes à toute une province. Chez Claridge, il ne sera pas constamment sous les réflecteurs. Il n'aura plus à expliquer publiquement les décisions de l'entreprise. Chez le Canadien, c'est une obligation qui l'a parfois placé dans l'embarras. Il a dû apprendre à mieux choisir ses mots et à jouer du violon dans certains cas. Il rappelle deux situations qui lui ont fait comprendre que le président du Canadien n'est pas monsieur Tout-le-Monde.
En 2003, il avait déclaré à l'auteur de ces lignes que le Canadien était dans un grand trou noir d'où il ne pourrait s'extirper avant cinq ans. Il rappelle en souriant que le Journal de Québec avait jumelé ses propos à une caricature représentant une bombe prête à exploser. C'est là qu'il avait réalisé l'importance de mieux choisir ses expressions.
Par ailleurs, deux ans après son entrée en poste, il avait ignoré un engagement de Serge Savard qui avait l'habitude de dire qu'à talent égal, le Canadien allait toujours choisir le joueur francophone. Dans le cadre d'une conférence, il avait affirmé que deux athlètes ne pouvaient jamais être de talent égal.
«Je m'étais fait joyeusement ramasser. Je ne pensais pas que je survivrais à ça. Même Donald Beauchamp m'avait grondé. Par la suite, je me suis fait à l'idée de jouer davantage la carte du politicien», précise-t-il, l'air amusé.
Malgré tout, il croit que cette responsabilité auprès du public lui manquera. Il affirme qu'il y a un petit quelque chose de revalorisant quand on a l'impression d'avoir assez bien assumé cette mission. C'est enivrant de savoir que le Canadien touche autant de monde, tant par ses hauts que par ses bas.
Il part plus tôt que prévu (son mandat devait se terminer le 30 juin) parce que la transition est complétée, parce que le nouveau venu Kevin Gilmore a déjà le nez dans tous les dossiers depuis un mois et parce que l'organisation traverse actuellement une période importante pour les budgets et la planification fiscale. Avec Geoff Molson, Gilmore et lui, c'était important que le Canadien ne projette pas une direction à trois têtes, selon lui.
La décision de Geoff Molson n'a pas été un choc
La décision du propriétaire d'aller s'asseoir dans le fauteuil du président ne l'a pas jeté par terre. Néanmoins, on quitte rarement le Canadien de gaieté de coeur, peu importe le poste qu'on occupe.
La nouvelle ne lui est pas tombée dessus comme une tonne de briques, cependant. M. Molson n'est pas entré dans son bureau en lui disant: «Désolé, mon vieux, mais c'est terminé.» Ce n'est surtout pas de cette façon que les choses se sont passées.
Il a vu venir la chose. Il a même prédit à son propriétaire que c'est précisément ce qu'il allait faire.
Deux semaines après la vente de l'équipe, Boivin a eu une première rencontre exploratoire avec le nouveau propriétaire.
Geoff Molson et lui se connaissaient fort bien puisque le jeune homme d'affaires siégeait déjà au sein du comité de direction du Canadien. Il représentait la tranche de 19% des actions qui faisaient de Molson le propriétaire minoritaire de l'équipe.
Ce jour-là, Boivin ne lui a demandé qu'une chose, celle de lui faire part de ses plans le plus rapidement possible. «J'étais un grand garçon; j'étais prêt à tout. C'est à ce moment que Geoff m'a annoncé son intention de quitter la Brasserie Molson et de s'installer au Centre Bell. Il m'a précisé qu'il n'avait aucun intérêt pour mon poste. Il voulait présider le conseil d'administration et gérer l'investissement de son groupe de partenaires. Cela lui apportait déjà suffisamment de responsabilités. Je lui ai prédit, au contraire, qu'il serait éventuellement tenté par mon poste.»
Quand Molson et son groupe se sont portés acquéreurs du Canadien, c'était déjà beaucoup pour le jeune entrepreneur. Il avait 38 ans. Il venait d'investir beaucoup d'énergie dans la création d'un groupe de partenaires. Toutefois, avec le temps, il a fait un cheminement qui l'a inévitablement convaincu de la nécessité d'en devenir le président. Boivin admet que s'il avait été dans la position de Molson, il aurait pris exactement la même décision. Voilà pourquoi il accepte son départ avec autant de sérénité.
Fait plutôt cocasse, pendant deux ou trois mois l'automne dernier, le jeune propriétaire a discuté avec Boivin des modalités du renouvellement de son contrat. Le président sortant n'a jamais vraiment cru qu'il se rendrait au bout de cette négociation.
«Je n'ai pas été surpris par sa décision de prendre possession de mon bureau, avoue-t-il. Je m'étais préparé pour une chose comme celle-là. Je suis heureux de la façon dont les choses se sont passées. Je suis satisfait d'avoir réussi à ramener l'entreprise entre les mains de Québécois et d'avoir participé à une transition sereine, sans claquage de portes, où tout le monde trouve sa place.»
Néanmoins, il lui sera très difficile de faire ses adieux à ses collaborateurs et collaboratrices du septième étage, mercredi. Il s'attend à vivre des derniers instants difficiles. Quand la porte de l'élévateur va se refermer derrière lui, en le laissant avec plein de souvenirs qui se bousculeront dans sa tête, il sait parfaitement ce qui va se passer.
«Je vais pleurer, c'est sûr, dit-il. Il va falloir que je m'essuie la face avant de me présenter dans le stationnement.»
(La suite mercredi)