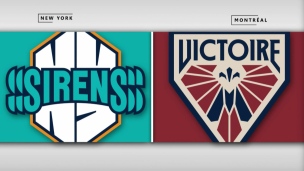11 septembre 2001
$content.firstChildCategorie mercredi, 9 juil. 2014. 18:47 vendredi, 2 oct. 2009. 19:26
J’y étais
New-York - 10 septembre 2001
Aujourd’hui j’arrive à New York car je dois faire l‘évaluation des joueurs de l’équipe de hockey des Rangers. Dès demain nous débuterons le travail au nouveau complexe sportif le Chelsea Peers au cœur de la Grande Pomme et nos chambres sont réservées à l’hôtel Marriot qui fait partie du complexe du World Trade Center.
Je vous décris ici l’atmosphère dans les rues de New-York en ce lundi. Personne ne sourit, ni ne se salut. Les gens marchent rapidement sans même réaliser qu’ils sont des millions à courir comme des fous sans échanger la moindre émotion, la moindre gentillesse. Ce sont des étrangers qui ignorent carrément de ceux qui marchent autour.
En chemin, Glen Sather, directeur général de l’équipe, nous informe que l’évaluation aura plutôt lieu au Madison Square Garden où les salles sont plus vastes et mieux adaptées à notre travail. Nous changeons d’hôtel pour être plus près de notre nouvelle assignation.
11 septembre 2001
Le 11 septembre 2001 demeurera une date historique à l’aube de ce troisième millénaire. Dès 6h00 du matin, nous nous rendons donc au Madison Square Center et installons nos équipements. Le travail va bon train, les joueurs plaisantent entre eux, l’évaluation est déjà bien commencée et l’atmosphère est excellente. Vers les 8H50, les lumières scintillent une première fois, comme si une panne d’électricité était éminente. C’est alors qu’entrent dans la salle Théorien Fleury et Sylvain Lefebvre, pâles comme des fantômes, qui nous annoncent qu’un avion vient de percuter une des tours jumelles du World Trade Center. À les regarder, impossible de croire à une blague. Nous courons tous vers l’unique poste de télévision et juste au moment où l’image apparaît, un deuxième avion frappe la deuxième tour. C’est la panique !
Nous réalisons tous que New York est attaquée à quelques pâtés de maisons seulement de l’endroit où nous sommes. Le Madison Square Garden, pour ceux qui ne connaissent pas la ville, est adjacent à la gare ferroviaire. Nous sommes tous convaincu que nous serons la prochaine cible dans les prochaines minutes. Dehors la foule court de tous côtés, les gens pleurent et sont affolés. Nous sortons voir se qui se passe.
Les policiers nous font rentrer et nous somment de demeurer à l’intérieur de l’édifice jusqu’à nouvel ordre. Les chiens pisteurs de reniflent partout à la recherche d’explosifs. On nous apprend alors que, pour les prochaines 48 heures, il sera impossible d’entrer ou de sortir de New York. Avions, trains, métro et autobus ne circuleront plus. Tous les aéroports américains sont fermés. Vers seize heures, M. Sather nous annonce qu’il a trouvé un hôtel. Nous pouvons enfin quitter le Madison Square Garden.
Partout dans la rue et même jusque dans le hall de l’hôtel, des gens apeurés, couverts des cendres déversées à la tonne par l’effondrement des Tours, au bord de la crise de nerfs nous accostent nous montrant des listes de noms ou des photographies et nous demandant si nous n’avons pas croisé ces personnes. La plupart pleurent et de grandes coulées noires descendent des yeux le long de leurs joues. Une femme m’apprend qu’elle était entrée au travail en retard après avoir laissé son enfant à la garderie. Ces quelques minutes de retard lui ont sauvé la vie. Maintenant elle cherche des collègues de travail disparus. Ses yeux vitreux me disent que sa tête est ailleurs au moment où elle me parle. Que répondre ? Je n’ai pas vu ceux dont elle me montre les photos. À ce moment, je réalise que nous avons tous besoin des uns et des autres.
Dans la chambre, que nous partagerons à 4, la fenêtre donne malheureusement sur Ground Zero. Nous demeurons tous muets devant ce spectacle de désolation terrible sentant que nous vivons un moment tragique de l’histoire de l’homme. Histoire pour laquelle il ne devra blâmer que lui-même. Le trou béant, fumant et géant n’est pas l’œuvre d’un cataclysme naturel. Il est le résultat de la lutte de certains hommes contre les autres. Et pour l’instant, les autres, c’est nous.
À la télévision on nous montre et remontre l’horreur qui se déroule à nos pieds. Quel sentiment étrange. Nous sommes sans voix. La sonnerie de mon téléphone, qui retenti tout-à-coup, nous fait sursauter. À l’autre bout du fil, Mario Lemieux veut s’assurer que nous nous portons bien. Il a aussi une bien triste nouvelle à nous apprendre: un de nos amis était passager d’un des avions aux mains d’un commando suicide. Avec nous dans la chambre, il y a E.-J. Johnston, le fils de l’ancien gardien de but des Pingouins de Pittsburg. À la télé défilent alors les numéros de vols, les lieux de départ et les destinations des avions détournés. E.-J. constate qu’il devait partir ce matin même à bord d’un de ces avions pour se rendre à San Francisco. Hier, je lui avais demandé de retarder son vol d’une journée afin d’assister à nos évaluations avec les joueurs des Rangers. Comment se sent-on lorsqu’on éprouve l’immense joie d’être encore en vie et, qu’en même temps, on ressent la terrible douleur d’avoir perdu un ami intime ? Chacun de nous s’isole dans ses pensées.
On décide de sortir dehors ou nous déambulons dans un décor apocalyptique au beau milieu de la rue. New York qui est reconnue comme étant la ville qui ne dort jamais, gît ce soir dans un coma profond alimenté par des respirateurs artificiels que sont les sirènes des véhicules d’urgence. Ce soir, nous retenons tous nos larmes. Les hommes ne pleurent pas.
_Mon unique ambition est maintenant de sortir de New York, de revoir mon épouse et mes enfants._
12 septembre 2001
Partout, les gens marchent lentement. Ils se parlent, se serrent dans les bras sans même se connaître. On peut sentir l’amour et l’entraide. New-York n’est plus la même. Le changement est radical.
Gaétan Lefebvre, du club de hockey Canadien, a alors une idée. Il récupère notre argent liquide et quelques laissez-passer qui nous ont été donnés par les Rangers. Il s’approche ensuite d’un employé de la gare et, lui glissant quelques billets verts entre les mains, il lui demande comment faire pour sortir d’ici. Sans répondre, il nous fait signe de le suivre. Au bord d’un escalier roulant qui remontait, il sort sa clé et change la direction de l’escalier qui descend maintenant Il nous guide à travers des couloirs et les sous-sols jusqu’à un quai. Là, un train vide attend en gare. Il nous installe dans le dernier wagon, en nous disant qu’il ne peut pas nous procurer de billets et que nous serons probablement expulsés à la prochaine gare. Mais, comme nous le désirons, nous serons sortis de New York.
Nous grimpons dans le train et nous nous cachons sous les banquettes. Nous voilà devenus passagers clandestins de ce train qui allait nous délivrer de ce cauchemar. Par la fenêtre nous voyons New York, couronnée d’une intense fumée. La vision est émouvante et pathétique. Le paysage, sans les tours, est complètement transformé.
Après un voyage de plus de 36 heures, je suis épuisé. Et en traversant le pont qui relie Sorel et Tracy, je me mets à pleurer. Incapable de me retenir plus longtemps. Je réalise que j’ai vraiment cru ne jamais revenir à la maison, ne jamais revoir les miens. Je réalise surtout l’importance d’avoir un chez soi où il y a des gens qu’on aime et qui nous aiment.
Lorsque je suis rentré dans la maison, ma femme, après des heures d’angoisse, avait fini pas s’assoupir. Elle avait appris que nous tentions de revenir, mais ignorait quand j’arriverais. Doucement, je m’approche d’elle. Elle ouvre les yeux et me regarde, et, incapable ni l’un ni l’autre de dire un mot, nous nous sommes enlacés pendant une heure en pleurant de soulagement. Je me suis ensuite rendu dans la chambre de mes deux petits anges qui dormaient. Je me suis blotti contre eux chérissant cet instant de bonheur. À ce moment, je me souviens clairement avoir pensé aux milliers d’enfants qui, cette nuit, attendront le retour d’un papa ou d’une maman qui ne reviendra jamais.
Mais avec du recul, qu’est-ce que j’ai appris de cette aventure du 11 septembre? J’ai réalisé qu’il existe toujours deux côtés à une médaille. Comme tout dans la vie, il y a le côté positif et le négatif. L’un ne peut pas exister sans l’autre. La vie est ce qu’elle est et nous sommes ce que nous sommes à cause justement de ces extrêmes. Il est triste de réaliser que malheureusement pour que les gens de New York se parlent il a fallu attendre une catastrophe. Je suis retourné à New York plusieurs fois par la suite et malheureusement l’amour et l’entraide du 11 et 12 septembre à maintenant fait place à l’individualiste d’avant les événements du 11 septembre 2001. Pour moi je n’ai plus jamais vu la vie de la même façon par la suite. Et vous?