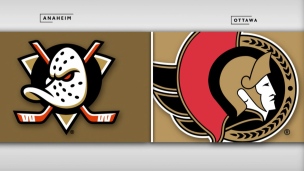Mystérieux et tourmenté
LNH jeudi, 18 avr. 2013. 09:55 jeudi, 12 déc. 2024. 06:34
Pat Burns, l'homme qui voulait gagner, la biographie d'un homme bourru au coeur tendre est lancée aujourd'hui à Montréal.
Ceux qui ont côtoyé Burns durant une carrière auréolée d'une coupe Stanley et de trois trophées Jack Adams, conserve de lui l'image d'un personnage intimidant, bourru, colérique, paranoïaque et souvent replié sur lui-même.
C'est d'ailleurs le portrait qu'en fait l'auteure, Rosie DiManno, une journaliste de carrière attachée au Toronto Star qui couvrait les activités des Maple Leafs de Toronto à l'époque où Burns en était l'entraîneur. Elle lève le voile sur les travers de cette personnalité difficile à cerner qui se faisait un devoir de ne pas se dévoiler aisément.
Le Pat Burns que nous avons connu à Montréal n'a pas été différent de celui qui a sévi à Toronto, à Boston et au New Jersey. Partout, il a eu des souffre-douleur, des joueurs sur lesquels il s'est acharné, soit parce qu'il voulait les rendre meilleurs, soit parce qu'il était incapable de les blairer. Partout, il s'est senti persécuté par les médias avec lesquels il favorisait souvent la provocation.
L'ouvrage est le portrait intéressant d'un homme qui ne laissait personne indifférent et qui nous a quittés beaucoup trop tôt, à 58 ans, des suites d'une accumulation de cancers, au colon, au foie et aux poumons, tout cela en l'espace de cinq ans. Burns, qui était constamment sur le sentier de la guerre, est pourtant parti en recevant des messages d'amour comme jamais il n'aurait osé en souhaiter.
Cette biographie a des longueurs alors qu'elle s'attarde avec beaucoup trop d'emphase sur les séries éliminatoires qu'il a disputées avec les quatre formations qui l'ont embauché. Après toutes ces années, ce n'est plus d'intérêt et cela n'ajoute pas grand-chose à la feuille de route de l'entraîneur que tout le monde connaît déjà fort bien.
On peut également s'interroger sur la précision de certains faits qui y sont racontés quand la journaliste, par exemple, mentionne que trois joueurs du Canadien, Chris Chelios, Shayne Corson et Petr Svoboda, ont embouti un lampadaire avant de capoter durant une série contre Boston. L'incident s'est plutôt produit tout juste à la veille des séries de 1988 et il n'y a pas eu de capotage. Elle précise aussi que les trois joueurs ont subi des blessures importantes, notamment aux chevilles. Or, Chelios, Svoboda et Corson ne donnaient pas l'impression d'être blessés quand ils ont couru à toutes jambes pour aller se cacher dans la cour du concessionnaire automobile voisin.
Le portrait qu'elle fait de Burns semble par ailleurs fidèle à la réalité. À l'extérieur des patinoires, il était d'un commerce fort agréable. Il aimait plaisanter. Il était même drôle. Au coeur de l'action, cependant, il était totalement différent. Il avouait détester les journalistes avec lesquels il était si cordial en d'autres occasions. Sur diverses tribunes, il se plaisait à les dépeindre comme des gens qui prenaient plaisir à critiquer ses décisions. Il n'était pas tendre à l'endroit de ceux de Montréal, sans doute parce que l'énorme pression qu'il a ressentie en pilotant le Canadien l'a incité à quitter la ville.
Un jour, après avoir cloué au banc Denis Savard à l'occasion d'un match à Detroit, il avait déclaré à la presse locale: «Quand vous laissez de côté un joueur francophone dans une équipe francophone, il y a toujours une levée de boucliers. À l'heure qu'il est, ma maison est probablement en train de brûler».
Quand un colis lui était livré, il le secouait en craignant qu'il s'agisse d'une bombe.
Ça, c'était le Pat Burns insécure et plaignard. L'auteure, dont l'amitié pour l'entraîneur n'échappe à personne dans ce bouquin, le fait souvent passer pour une victime toujours prête à être immolée par la presse francophone. Une allusion fausse et répétitive sur laquelle Burns a probablement insisté avec elle.
Il était comme ça, Pat. Un fin raconteur, ses histoires étaient souvent romancées, comme celles rattachées à sa carrière de policier qu'il se plaisait à ramener sur le tapis dans toutes les villes. Comme entraîneur, il se sentait persécuté, toujours en train d'anticiper le pire pour lui-même. C'était un dur qui se rebiffait souvent en usant d'intimidation. Il donnait l'impression d'être mal dans sa peau. Un membre de sa famille doute d'ailleurs qu'il ait déjà été vraiment heureux.
Burns avait trois ans quand son père est décédé d'une crise cardiaque à 49 ans. Selon ses proches, la guidance paternelle qu'il n'a jamais eue permettrait d'expliquer beaucoup de choses. Il a été élevé et protégé par des femmes, sa mère et ses quatre soeurs.
La mort de son père a creusé chez lui un vide qu'il n'a jamais réussi à combler. Il n'a jamais su être un père pour ses deux enfants parce qu'il n'en a jamais eu un. Il était un père absent parce que son premier emploi de policier et la carrière d'entraîneur qui a suivi ont occupé toute la place dans son quotidien.
Il était un entraîneur de la vieille école où les coups de pied dans les poubelles au centre du vestiaire étaient la façon la plus logique de démontrer son mécontentement. À ses yeux, les joueurs qui portaient la visière étaient des froussards. Pour lui, la psychologie n'était qu'un terme qu'on retrouve dans le dictionnaire. Il ne croyait pas qu'elle puisse être utile dans l'exercice de ses fonctions. Deux de ses victimes les plus soutenues, Claude Lemieux et Stéphane Richer, pourraient en témoigner.
Un coup de pied au derrière
Cette biographie s'attarde longuement sur ses associations avec le Canadien, les Maple Leafs, les Bruins et les Devils et sur les raisons qui ont motivé ses embauches et ses congédiements. Également sur sa façon de se comporter avec ses joueurs qui a souvent été responsable de ses renvois. Comme s'il s'était senti obligé de projeter une image de macho dans un sport qui l'était déjà beaucoup.
Il en exigeait tellement de ses joueurs que son style bulldozer n'avait plus aucun pouvoir au bout de trois ou quatre ans. Des athlètes ne peuvent pas foncer le pied au plancher durant 82 matchs, mais l'intensité de gagner qui brûlait en lui l'empêchait d'en tenir compte. À ce sujet, l'entretien que le président et directeur général des Devils du New Jersey, Lou Lamoriello, a eu avec lui avant de lui confier ce qui allait devenir sa dernière équipe, est l'un des passages les plus intéressants de ce livre.
Lamoriello a commencé par lui préciser que son équipe possédait tous les ingrédients pour gagner la coupe Stanley. Cependant, pour y arriver, elle n'avait pas besoin du type d'entraîneur qu'il avait été jusque-là durant sa carrière. Pour mériter le poste, Burns se devait de changer. Il préconisait un style qui usait tout le monde autour de lui, y compris lui-même.
Burns a été étonné qu'on s'adresse à lui avec autant de franchise. Selon Lamoriello, il ne comprenait pas pourquoi il en venait toujours à perdre ses joueurs après avoir connu du succès. Il l'a ramené sur terre en des termes on ne peut plus directs.
«Quand l'équipe commence à faire de mieux en mieux, tu en viens à penser que c'est à cause de toi, lui a-t-il dit. Tu oublies que c'est à cause des joueurs. Dès qu'ils se rendent compte que tu penses que c'est à cause de toi, tu te retrouves dans le pétrin.»
Burns était sans travail depuis deux ans. Il voulait ce job avec une équipe capable de lui procurer la coupe. La remontrance de son futur patron l'a fait réfléchir. Jamais personne ne lui avait parlé de cette façon.
«Je lui ai dit que ce qu'il avait à faire, c'était d'aimer ses joueurs plutôt que de leur prouver qu'il était un dur. Être dur est un état d'esprit, ce n'est pas un message. Comme c'était le cas avec ses joueurs, Pat avait besoin d'un bon coup de pied au derrière et d'être aimé ensuite», explique le patron des Devils.
Burns a tenu compte de ces remarques. Il a finalement gagné la coupe Stanley et Lamoriello a pris soin de lui et de sa famille jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle. Curieusement, Lamoriello est peut-être devenu le père qu'il n'a jamais eu.
Une fin de vie attendrissante
C'est la maladie qui l'a obligé à abandonner son poste. Même dans les moments les plus éprouvants de ses traitements, Burns n'a jamais eu à s'inquiéter pour son contrat. Il est devenu une sorte de conseiller auprès de Lamoriello. Il a gardé le contact avec quelques-unes de ses meilleures relations dans le hockey. Il était toujours au téléphone à la recherche d'informations. En Floride, il assistait à des matchs, souvent en compagnie de Scotty Bowman, afin de garder ses notes à jour.
Il a vraiment démontré quel genre d'homme il était quand il s'est acquitté de son rôle quotidien d'analyste à CKAC dans les derniers moments de sa vie. Certains jours, il semblait pétant de santé. On l'aurait cru prêt à reprendre sa place derrière le banc. D'autres matins, sa voix redevenait rauque. Il n'y faisait pas allusion, mais on sentait qu'il en arrachait.
Burns a été un homme de hockey jusqu'à la toute fin. Ses funérailles ont été célébrées par l'archevêque de Montréal dans une cathédrale bondée de gens de hockey et d'admirateurs. Son âme et ses cendres reposent dans une urne en forme de coupe Stanley.
Si seulement le Panthéon de la renommée du hockey n'avait pas boudé la possibilité de l'accueillir avant sa mort, l'hommage aurait été complet. Le gros Pat, qui a été beaucoup plus aimé qu'il ne l'a jamais imaginé, aurait su à quel point il était respecté par ses pairs s'il avait été intronisé pendant que le cancer jouait cruellement avec sa vie. Après plus de 1 000 matchs, de 500 victoires, de trois trophées Jack Adams et d'une coupe Stanley, il aurait mérité d'en avoir la confirmation de son vivant.
Pat Burns, l'homme qui voulait gagner nous en dit beaucoup sur le parcours difficile d'un entraîneur aussi bagarreur que courageux.