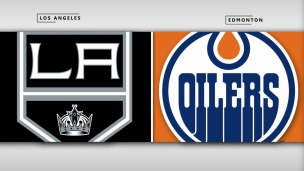La NCAA, une option de plus en plus populaire
Hockey mercredi, 9 mai 2018. 10:17 jeudi, 2 mai 2024. 02:18
MONTRÉAL – Avant d’amorcer une carrière professionnelle de sept saisons dans l’Association mondiale de hockey, Pierre Guité a débuté son développement dans une ligue junior de l’Ontario et l’a terminé à l’Université de la Pennsylvanie. Mais quand son fils Ben est arrivé dans ses traces, au milieu des années 90, les règles s’étaient resserrées et il n’était plus possible d'emprunter les deux avenues. Une décision s’imposait.
« Mon père avait vu les deux côtés de la médaille et si son fils était assez bon pour aller d’un côté ou de l’autre, il n’y avait pas de doute dans sa tête qu’il irait à l’université. Je n’ai pas eu le choix! », raconte en riant celui qui a finalement représenté les Black Bears de l’Université du Maine pendant quatre ans.
Près de vingt ans après son dernier match universitaire, Ben Guité se retrouve du côté des influenceurs. Dans ses fonctions d’entraîneur-adjoint pour l’équipe de son alma mater, il faisait partie de la quinzaine d’entraîneurs de la NCAA qui avaient convergé en fin de semaine dernière vers le Centre sportif Dollard-St-Laurent de Montréal pour participer au camp de hockey Apex.
Le camp Apex est une vitrine astiquée depuis huit ans par Phil Roy et Claude Morin, deux anciens de l’Université Clarkson qui se sont rencontrés lors d’un colloque d’entraîneurs en marge du repêchage de la LNH qui avait lieu au Centre Bell en 2009. L’idée de base était modeste : une brève séance d’information au cours de laquelle les aspirants étudiants-athlètes et leurs parents pouvaient recevoir toute l’information nécessaire sur les différents chemins qui peuvent mener à la NCAA. Mais en deux ans, elle s’est transformée en un carrefour unique vers lequel migrent à chaque printemps des recruteurs de programmes de division I et division III du nord-est américain. Pendant trois jours, ces derniers supervisent des entraînements et dirigent des matchs qui leur permettent d’observer, lors d’une même fin de semaine, une centaine de joueurs. Certains, désireux d’évaluer toutes leurs options, y sont par simple curiosité. D’autres espèrent carrément y décrocher une bourse d’études.
« Tu viens ici, c’est un one-stop shop, résume Roy, qui fait partie du personnel d’entraîneurs des Golden Knights de Clarkson depuis sept ans. Tu as la chance de te faire voir devant une quinzaine d’universités américaines, une opportunité que la plupart des jeunes d’ici n’ont pas durant l’année. En plus de pouvoir montrer ce que tu sais faire sur la patinoire, tu peux poser toutes les questions que tu veux sur les conditions d’admissibilité, les exigences académiques et la réalité d’un joueur universitaire. Et le but ultime, c’est de trouver un hameçon et de se faire recruter. »
Le camp Apex accueillait cette année des joueurs divisés en deux groupes d’âge : ceux nés entre 1997 et 2000, qui sont donc âgés de 17 à 20 ans, et ceux nés entre 2001 et 2003, qui ont l’âge pour évoluer au niveau midget AAA.
« Tu sais, c’est facile aller jouer junior majeur. Tu te fais repêcher, tu te présentes au camp et tu fais l’équipe ou tu ne la fais pas. Mais pour accéder au circuit universitaire américain, la route est moins linéaire, explique Ben Guité. Dans un camp comme celui-là, on leur parle des possibilités. »
Des alternatives à la LHJMQ
Ces possibilités sont nombreuses. Aux États-Unis, la United States Hockey League (USHL) n’a plus besoin de présentation. Les Québécois Alex Chiasson, Louis Leblanc et Michael Matheson, notamment, ont emprunté cette voie. En 2017, quatre joueurs y évoluant ont été sélectionnés en première ronde au repêchage de la LNH.
Au Canada, des ligues juniors s’imposent de plus en plus comme des escales de qualité vers la NCAA. En 2016, Tyson Jost et Dante Fabbro ont mis la British Columbia Hockey League (BCHL) sur la mappe lorsqu’ils ont été repêchés en première ronde par l’Avalanche du Colorado et les Predators de Nashville, respectivement. Cale Makar, un autre choix de première ronde de l’Avalanche, avait opté pour l’AJHL, une ligue junior de l’Alberta, en attendant de faire le saut à l’Université du Massachusetts à Amherst.
« Il y a toujours eu des choix de première ronde américains qui sortent de la NCAA. Mais maintenant, on voit de plus en plus de joueurs d’élite canadiens qui décident de venir ici. Ça nous donne beaucoup de crédibilité, remarque Ben Guité. Les gens sont curieux, ils veulent en savoir plus, ils veulent savoir comment se rendre là. »
Plus près d’ici, la Ligue junior AAA du Québec, la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS) et les équipes collégiales du Réseau de sport étudiant du Québec (RSEQ) permettent d’évoluer dans un cadre compétitif tout en demeurant éligible à une bourse d’une université américaine.
« Au Québec, le hockey scolaire est en arrière de ce qu’on retrouve aux États-Unis et dans l’Ouest canadien, où tout passe depuis toujours par les écoles, compare Claude Morin, qui est le responsable des sports au Cégep André-Laurendeau. Ici, ça a commencé à se développer dans les dix dernières années et depuis cinq ans, il y a eu une explosion des programmes. La voie scolaire, les gens y croient et ils font leurs recherches. »
Morin cite en exemple le cas de Pierre-Luc Mercier, un ancien élève qui a été recruté par l’Université Bowling Green en 2013 après avoir participé au camp Apex. Samuel Vigneault, un autre ancien du Boomerang, a joué trois ans à Clarkson avant de passer chez les pros avec les Monsters de Cleveland, dans la Ligue américaine. Simon Bessette et Devin Brosseau sont d’autres Québécois qui ont convaincu Phil Roy lors de leur audition au camp Apex.
« Les Québécois sont plus ouverts, sent Guité. Le côté académique offert par la NCAA a toujours été valorisé, mais le monde se disait peut-être que ce n’était pas la meilleure façon pour monter les échelons. Là, ce n’est plus nécessairement vrai. »
La LNH, une destination possible
Depuis que l’initiative a vu le jour, elle a permis à plus de 60 hockeyeurs québécois de décrocher une bourse d’études aux États-Unis. Plusieurs d’entre eux ont fait leurs valises en rêvant encore à la LNH. Selon College Hockey Inc., qui chapeaute les 61 programmes de division I aux États-Unis, 32% des joueurs qui évoluaient dans le circuit Bettman en 2017 provenaient des rangs universitaires américains, une hausse de 11% par rapport à 2003.
« Au Maine, on a Rob Michel, un défenseur qui vient du nord de l’État de New York, offre Ben Guité en guise d’exemple. Il est arrivé chez nous à 21 ans et l’an prochain, il va sortir avec son diplôme en ingénierie électrique et un contrat professionnel. Déjà cette année, il a eu des offres de quatre ou cinq équipes pour sortir plus tôt, de l’argent de première ronde. Pour lui, ça a juste pris un peu plus de temps. C’est parfois tout ce dont certains joueurs ont besoin. »
« Regarde ce qui se passe dans la Ligue nationale avec les joueurs de la NCAA, renchérit Claude Morin. Deux des trois candidats au titre de recrues de l’année en proviennent. Et regarde les séries que connaît Jake Guentzel! On en entend parler de plus en plus et il y en a qui se disent que si c’est bon pour eux, peut-être que c’est aussi bon pour moi. C’est ce qu’on essaie de promouvoir. »
Et les universités canadiennes, dans tout ça? Morin se défend de les négliger. Il note avec fierté qu’on retrouve quelques-uns de ses anciens poulains à Ottawa, Concordia et Trois-Rivières. Mais s’il mousse davantage les débouchés qui s’offrent au sud de la frontière, c’est simplement qu’ils s’imposent comme une possibilité plus réaliste.
« Ce n’est pas nécessairement qu’on veut envoyer nos gars aux États-Unis, mais les universités canadiennes doivent se réveiller, tonne-t-il. À 20 ans, au Québec, les gars n’ont plus d’options. Il y a Concordia, Trois-Rivières et McGill. Trois équipes, dont deux anglophones, qui peuvent se servir dans un énorme bassin et qui, au total, ne peuvent accueillir qu’environ 75 joueurs. Donc ça prend des options. C’est pour ça qu’on travaille beaucoup vers les États-Unis, où il y a 61 équipes de division 1 et 87 équipes de division III. Et la renommée de la NCAA, l’argent et l’encadrement qui sont offerts par ces programmes, il n’y a rien qui accote ça. Tout le monde qui l’a vécu vous le dira. »
« On ne dit à personne quoi faire, mais on veut présenter ce qu’on croit être une avenue intéressante, conclut Phil Roy. Combien de fois j’ai entendu ‘Ah, si j’avais su...’? Il n’y a pas de mauvais choix, mais dans toutes les années où j’ai fait ça, j’ai vu beaucoup de monde prendre une décision d’un côté sans savoir ce qui se passe de l’autre. C’est ce qu’on offre ici. »